Peuples racines et racines des peuples
Les peuples racines sont détenteurs de savoirs et porteurs de sagesses
essentielles pour redéfinir notre place d’être humain dans le monde. Audelà
de leur lien à la nature, leur relation à l’invisible et leurs conceptions
de l’être et du devenir nourrissent une spiritualité éminemment moderne.

Alors que les crises qui secouent l’humanité se multiplient et que leur fréquence s’accélère, l’avenir semble bien sombre. Regarder vers l’avant est inquiétant et difficile. Regarder vers l’arrière peut alors être utile, mais c’est bien au présent que tout se joue. Se poser la question « comment en sommes-nous arrivés là ? » est un devoir qui peut nous aider à sortir des crises et à ne pas répéter les mêmes erreurs, mais cela demande à se projeter dans le temps long, et la culture, voire le culte, de l’immédiateté n’y aide pas. Il est bien connu que l’homme occidental moderne s’est coupé de la nature en prenant progressivement au pied de la lettre l’injonction biblique consistant à « soumettre la nature », à l’exploiter sans limite afin de « croître et multiplier ». Renaissance, Lumières puis révolution industrielle ont entériné cette domination de l’homme sur le vivant et l’inanimé, cette toute puissance de la raison et son pendant technoscientifique. Plus dure est la chute car nous avons simplement perdu de vue que nous ne sommes pas à l’écart de la nature, ni au-dessus ni à côté, mais que nous sommes dans et de la nature.
Deux regards antagonistes
Ceux qui n’ont pas oublié cela, et qu’on appelle peuples racines, peuples premiers, autochtones ou indigènes, sont l’objet aujourd’hui de deux types de regard antagonistes. Soit ils sont des « archaïques » dont le mode de vie appartient au passé et qui ne sont pas « entrés dans l’Histoire ». Soit au contraire ils sont les détenteurs d’une sagesse immémoriale qui peut sauver le monde moderne en nous invitant à nous « reconnecter » à la nature et y retrouver notre juste place. Comme toujours, la réalité est un peu plus subtile et moins tranchée, même s’il serait tout aussi faux de dire qu’elle se situe à michemin entre ces deux visions. Selon les données de l’Organisation des Nations unies diffusées lors de la Journée Internationale des peuples autochtones le 9 août, quelques 476 millions d’autochtones vivent aujourd’hui dans 90 pays sur la planète, soit 6,2 % de la population mondiale. On parle de 5000 communautés environ qui ont conservé autant que faire se peut une identité ethnique et des modes de vies traditionnels sur des territoires ancestraux. En outre, ces territoires qui couvrent 28 % de la surface terrestre abritent 80 % de la biodiversité mondiale. Ces quelques chiffres suffisent à comprendre combien il est important de considérer ces peuples et se pencher sur leurs visions du monde. En effet, leurs modes de vie préservent les écosystèmes et la biodiversité et leurs savoir-faire sont particulièrement utiles pour lutter contre certains effets du dérèglement climatique comme les gigantesques incendies qui ravagent tant de zones boisées sur la planète. Ainsi les populations aborigènes ont-elles été récemment consultées par les autorités australiennes suite aux feux destructeurs de l’été 2020 car ces populations emploient des méthodes de déboisement préventif ou de feux contrôlés depuis des millénaires. De la notion d’équilibre des échanges et des prélèvements (zigoneshi chez les Kogis de Colombie) à celle de joie (encipaï chez les Maasaï d’Afrique de l’Est), en passant par l’harmonie, la force vitale, l’énergie primordiale, la conception cyclique du temps, l’intelligence intuitive, etc., il ne s’agit pas seulement de vouloir sauvegarder des cultures et des coutumes, des langues et des « folklores ».
Richesses des mythes et récits
Nous autres Occidentaux modernes sur-éduqués et surinformés avons tout simplement beaucoup à apprendre de ces savoir-faire et savoir-être, à la fois au plan individuel et au plan collectif. Car, outre cette relation au vivant et à la terre, à la nature et aux éléments, il est absurde et prétentieux de voir en eux des « primitifs radicalement différents de nous autres civilisés parce que, selon Lucien Levy-Bruhl (sociologue et anthropologue français du début du XXe siècle), ils sont demeurés infantiles et vivent dans un univers mystique, mythique et magique », comme l’écrit Edgar Morin dans Natives1. Au contraire, leurs mythes sont d’une grande richesse et d’une grande diversité qui sont aussi une marque de maturité et de réflexion. Comme le souligne l’anthropologue Jean- Loïc Le Quellec, « un mythe est au sens propre un récit (…) qui concerne des événements situés dans un temps inaccessible aux humains »2, et ils se répartissent en récits cosmogoniques (sur l’origine du monde), anthropogoniques (sur l’origine de l’homme) et même ethnogoniques (sur l’origine des peuples) et sociogoniques (sur l’origine des sociétés et des classes sociales). Les mythes qui exposent l’origine de l’humanité sont euxmêmes bien plus diversifiés qu’on peut le supposer, car les chercheurs en recensent « une douzaine de catégories, dont la fréquence et la répartition diffèrent grandement », souligne Jean-Loïc Le Quellec. Le plus répandu est celui de « l’Émergence primordiale », qui « raconte l’émergence dans ce monde d’êtres qui existaient déjà auparavant dans un autre et qui sont d’origine chthonienne, c’est-àdire souterraine. » Mais d’autre mythes sont célestes (les humains sont venus des cieux), terrestres (l’homme fut modelé à partir de la terre, comme dans le « mythe » de la Genèse), ou encore animaux (les humains sont d’origine animale, à l’instar du « mythe » darwinien) ou végétaux. Ainsi, les « genèses » amérindiennes ou océaniennes sont tout aussi riches et poétiques que celle de la Bible, souligne l’anthropologue.
Relation à l’invisible
Au-delà de la relation au monde tel qu’il nous apparaît, les peuples racines entretiennent une relation constante et primordiale à ce qu’on appelle « l’invisible ». Là aussi, notre rationalité occidentale n’y voit que pensée magique alors qu’il s’y trouve à coup sûr des sources d’enseignements et tout simplement une réalité tangible. Tout dans la nature, animé ou inanimé, et à toutes les échelles, a une âme ou un esprit. Les ancêtres euxmêmes restent présents et sont honorés à la fois comme des guides et des gardiens. Cette notion d’intelligence et de sensibilité du vivant commence à peine à être reconnue par la science, comme par exemple la façon dont les plantes sont capables de communiquer entre elles par des voies chimique aériennes ou des voies souterraines, en nouant des « partenariats », des alliances ou des symbioses. Sur la réalité de l’âme et de sa survie chez l’être humain, la science reste circonspecte voire complètement fermée mais les témoignages et les données abondent en ce sens. Certes, il s’agit là d’une question qui appartient au champ du religieux, donc pas entièrement exclue de notre vision occidentale et moderne du monde, mais la raison nous enjoint de n’y voir que croyance et superstition. De fait, entretenir chez nous une relation à l’invisible selon ce type de modalités relève d’une néo-spiritualité qui n’est guère prise au sérieux. Nous avons exploré par ailleurs, avec Romuald Leterrier3, combien les savoirs des chamanes shipibos-conibos d’Amazonie, par exemple, résonnent avec nos concepts modernes de synchronicités et d’états modifiés de conscience. « Continue ta diète et, bientôt, les arbres, les rochers, les animaux, les vents et les rivières vont t’enseigner le savoir des signes », avait dit le chamane Ernesto à Romuald en pleine jungle.
Portes de la perception
« La nature n’est pas une compétition, avait-il poursuivi. Il faut la voir et surtout l’entendre comme une musique faite de rythmes, d’harmonies, c’est pour cela que nous, les chamanes, nous utilisons des chants pour entrer en relation avec la vie. La nature est comme une mère qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Regarde les animaux de la Selva (jungle), chacun de leurs besoins trouve une réponse. Quand tu fais la diète, tu retrouves ta part et ta sensibilité animales. Et c’est par cette part animale que tu peux alors recevoir les signes qui sont des réponses de la nature et de l’univers. » Cette richesse de sens qui se trouve dans la nature - qui n’est pas un « environnement » comme on le pense ici, car nous en sommes partie prenante – a de nombreux échos dans toutes sortes d’expériences. Bien sûr, celles qui font suite à la prise de certaines substances psychotropes comme la préparation ayahuasca ont beaucoup fait parler d’elles car elles ont un caractère spectaculaire et mystérieux. Elles semblent en effet ouvrir « les portes de la perceptions », selon la fameuse formule d’Aldous Huxley. Quand j’en parlai les premières fois avec Romuald Leterrier, qui a étudié ces questions en tant qu’ethnobotaniste sur le terrain amazonien, il m’expliqua : « Pour les indiens d’Amazonie, les plantes sont nos ancêtres, elles sont nos grand-mères et nos grands-pères. Ils savent que les végétaux ont peuplé la Terre en premier, puis créé les conditions de la vie (la biosphère), parce que les plantes ellesmêmes le leur ont enseigné ! » Ainsi, là où nous voyons des « règnes » distincts, eux voient un simple continuum entre végétal, animal et humain. Lors d’une cérémonie chamanique avec prise d’ayahuasca, Romuald pense que, « du fait de ce lien de parenté, il y a une interaction très forte entre les substances chimiques émises par les plantes et la conscience de l’expérienceur, à laquelle elles s’adaptent, comme un phénomène symbiotique, pour aller chercher en lui son mode de communication, son langage émotionnel, mémoriel, au cas par cas ».

Voyages dans le temps
Le plus extraordinaire est que le savoir de ces chamanes répond aux réflexions de la physique contemporaine sur la nature du temps. « Le temps est un effet de notre ignorance des détails du monde », explique le physicien Carlo Rovelli, et dès lors il n’a pas d’existence fondamentale et se réduit à une forme d’illusion. Une part de nous-mêmes est alors capable de s’extraire de cette dimension pour effectuer ce qu’il convient d’appeler des « voyages dans le temps », qui sont des voyages de la conscience, à travers les visions et les rêves, en particulier. De nombreuses cultures, à commencer par les Aborigènes d’Australie, accordent au rêve une importance cruciale. Chez eux comme pour les Ojibwés du Canada, le temps est circulaire et la réalité émerge d’une boucle causale articulée entre le rêve – qui en est la vision – et le constat objectif – qui en est la « densification », la « réalisation » ou concrétisation. Dans ces traditions, on se raconte ses rêves au matin car ils orientent la journée en indiquant par exemple les opportunités de chasse et les rencontres à venir. Chez les Hopis et les Navajos, il n’existe pas de notion dissociable d’espace et de temps, mais une distinction est établie entre « manifestant » (réservoir de possibles) et « manifesté » (ce qui apparaît). Ainsi, on se déplace dans le temps comme on se déplace dans l’espace, et Einstein aurait pu trouver là une inspiration pour son concept d’espace-temps. Cette exploration de l’invisible à travers les rêves et les visions, que les transes soient induites par des substances psychédéliques, des rythmes de tambour, des chants…, traduit simplement le fait que cet autre versant de la réalité ne fait qu’un avec notre réalité matérielle. La richesse des pharmacopées traditionnelles – largement pillées par nos « laboratoires pharmaceutiques » - provient de cette communication avec l’esprit des plantes. Ce sont les plantes elles-mêmes qui indiquent, dans les visions ou les rêves, comment elles doivent être utilisées, dans quel but et surtout selon quelles associations. L’exemple de l’ayahuasca est éclairant, parce que son action est permise par une combinaison subtile de deux ingrédients essentiels qui dépasse la possibilité d’avoir trouvé la bonne formule par un simple processus d’essais et erreurs. La science redécouvre seulement l’immense potentiel thérapeutique de ces substances qui « élargissent » la conscience4.
Nouveau contrat social
Ainsi nous voyons combien notre rationalité est limitante et quel potentiel de connaissances sur la nature humaine recèlent les savoirs traditionnels. Le risque est cependant d’idéaliser ces savoirs et ces cultures et d’ignorer ce qui en constitue aussi la face sombre, comme par exemple les pratiques de mutilation sexuelle ou de superstition à l’égard de certaines catégories d’individus ; on pense au sort des albinos persécutés en Tanzanie ou ailleurs. En outre, hormis certaines tribus « non-contactées », ces peuples racines ont également évolué au fi l du temps et notamment au contact des Blancs. Ils n’appartiennent pas au passé mais bien à l’humanité plurielle d’aujourd’hui, et certains utilisent l’ordinateur et le smartphone pour, paradoxalement, préserver leur identité et leur mode de vie. À l’instar d’autres « minorités », il ne suffi t pas d’une journée internationale comme celle décrétée par l’ONU pour se préoccuper du sort de ces peuples. Dans la majorité des pays où ils vivent, ils sont sous la menace constante de pratiques d’exploitation forestière et d’extraction minière (y compris sur le territoire français de Guyane), et sont même, sous couvert de bonnes intentions, menacés d’expulsion là où l’on veut établir des sanctuaires sous forme de « parcs naturels » et autres aires protégées. Plus globalement, le regard condescendant sinon méprisant porté sur eux par trop de nos contemporains menace la survie de leurs langues, leurs cultures et leurs communautés mêmes. Ils sont, plus que les autres, victimes de l’ostracisme et des inégalités là où ils ont été colonisés par les Européens. C’est essentiellement le cas sur le continent américain et les développements récents autour des « pensionnats autochtones » du Canada montrent combien ces plaies sont loin d’être refermées. À l’occasion de la journée du 9 août dernier, le Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones a appelé à un nouveau « contrat social » dans le cadre duquel « leurs propres formes de gouvernances et modes de vies doivent être respectés et fondés sur leur consentement libre, préalable et éclairé ».
Le communiqué indique également que « le nouveau contrat social doit être fondé sur une participation et un partenariat authentiques qui favorisent l’égalité des chances et respectent les droits, la dignité et les libertés de tous. Le droit des peuples autochtones à participer à la prise de décision est un élément clé pour parvenir à la réconciliation entre les peuples autochtones et les États
Jocelin Morisson
Rédacteur en chef de Natives
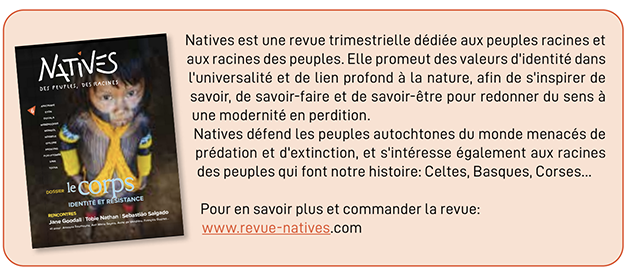
Paru dans l'Agenda Plus N° de

