L’évolution au masculin
Vers leurs dimensions émotives et sensibles. Vers eux-mêmes. Vers une nouvelle paternité. Vers les femmes. Solidaires de l’humanité et de la Terre… Les hommes en évolution.

Téléchargez ici la version du dossier au format PDF
“Qu’est-ce qu’être homme ?”, voici une bien curieuse question. Elle se pose en des termes nouveaux depuis une grosse trentaine d’années. Auparavant, les hommes pensaient n’avoir aucun intérêt à se pencher sur la question de leur identité. Ils évoluaient dans un monde où l’inégalité entre hommes et femmes était une donnée qui allait de soi. C’est ce constat que dresse l’anthropologue Françoise héritier dans sa très sérieuse étude où elle questionne les représentations de la différence des sexes propres à différentes sociétés1.
Qu’observait-on dans les sociétés archaïques ? on observait que les femmes ont des enfants et que les hommes n’en ont pas. Et ce qui était encore plus étonnant pour ces sociétés, c’est que les femmes mettent au monde des hommes. Pour nos mentalités contemporaines, cela ne pose guère question.
Mais on ne se figure pas assez que nous avons des moyens scientifiques qui nous permettent de réfléchir le monde tout à fait différemment par rapport à l’antiquité. Nous disposons de tout un arsenal de connaissances qui nous permet de décrire les processus en cours dans la fécondation, ceci grâce à des radiographies, des échographies, des tests de laboratoire... Les moyens de construire les définitions du masculin et du féminin ont donc changé… depuis peu.
Une pensée insupportable...
Pour les anciens, une femme devait logiquement engendrer un être identique à elle-même. Elle devait donner obligatoirement naissance à une femme. or, ce n’est pas ce qui se passe. La femme engendre aussi un homme. Les hommes doivent donc passer obligatoirement par des femmes pour exister. Leur existence ne dépend pas d’eux puisqu’ils ne peuvent pas se reproduire, ce que peuvent faire les femmes. Cette pensée a été vécue comme insupportable, injuste, mystérieuse et les hommes se sont alors échinés à s’approprier la fécondité des femmes.
Puisque la survie de l’espèce, et des hommes, est liée à la fécondité, donnée extrêmement importante, il était essentiel d’avoir des femmes dans le groupe. Les femmes ont donc été jugées utiles parce qu’elles étaient reproductrices. D’où la mainmise totale sur elles, qui se résume par : « Les hommes doivent avoir des femmes pour que la survie ait lieu ». Les pères et les fils disposaient d’elles, les échangeaient, les vendaient, les utilisaient, les raptaient aux autres groupes.
Vient alors la théorie d’Aristote. Celuici affirme la lutte du masculin et du féminin dès le rapport sexuel du couple, comme l’explique Françoise héritier : «Un rapport réussi est celui où la semence impose le masculin à une matière féminine qui se reproduirait autrement à l’identique. Pour Aristote, la naissance des filles est la première monstruosité, elle signe l’échec du masculin, lors d’une épreuve de force constamment renouvelée».
La pensée masculine qui se construit à ce moment-là pour s’approprier la fécondité féminine est de dénigrer le rôle de la femme : elle est « seulement » un contenant qui porte et accouche.
Un ordre en train de se renverser
La culture patriarcale s’est alors édifiée, marquée par la dictature du masculin sur le féminin. Mais si cet ordre a prévalu jusqu’à maintenant, il est en voie de se renverser. Et cela notamment depuis que la femme a pris le contrôle de sa propre fécondité. Il y a toujours eu des moyens de contraceptions, mais il se fait que leur pratique est maintenant généralisée, du moins dans les sociétés occidentales. Ce droit à la contraception donne lieu à une indépendance économique et de pensée. tout change du rapport entre hommes et femmes à partir du moment où les femmes ont le choix de disposer de leur corps. Elles ne dépendent plus de leurs grossesses. Elles sont libres d’enfanter autrement qu’en ayant des enfants sans en avoir décidé.
Il est fini le temps où l’homme devait «secourir» la pauvre femme fragile. Il est terminé le temps où l’homme pouvait faire endosser à la femme sa propre anxiété, angoisse, détresse, souffrance, et où celle-ci le cautionnait. Maintenant, ses propres blessures qu’il projetait sur la femme «extérieure» lui sont redonnées. Et lui, qui a si peu l’habitude de prendre soin de son monde émotif, lui qui a négligé et méprisé ce monde sensible qu’il attribuait à la femme, lui qui l’a réprimé, il lui faut maintenant le reconnaître et en prendre soin…

Les nouveaux hommes existent
L’homme est enfin rendu à lui-même. Et ce n’est pas facile pour lui d’avancer dans l’inconnu. L’inconnu, nombre d’hommes y font face. Les hommes de la trentaine n’ont plus honte d’être tendres et sensibles, et prennent leurs bébés dans leurs bras. Ils ne sont peut-être pas majoritaires, mais ils sont visibles. on les voit dans la rue. on les voit dans les magasins. Ils sont nos compagnons, nos voisins, les amis de nos fiIles - et de nos fils aussi, dans le cas d’un couple homosexuel. Les nouveaux hommes existent, nous devons reconnaître leur intelligence et aussi leur courage.
Car il faut du courage pour remettre en cause les privilèges du pouvoir. Confort patriarcal ? oui, car il y avait du confort à être dominant, du confort à s’ériger en seul juge et connaisseur du monde extérieur et de la gouvernance des cités et des états, du confort à prendre la parole. Mais que le prix à payer fut cher. Cher pour les femmes, à qui violence constante a été faite. Mais cher aussi pour les hommes eux-mêmes, enfermés dans leurs armures…
Héros, séducteurs, bon père de famille : assez !
Guy Corneau montre, dans son fameux best-seller «Père manquant, fils manqué » combien la blessure des hommes part de la relation aux pères. Pères héritiers des valeurs de leurs propres pères. Pères du patriarcat. Pères souvent froids, ou arborant une forme de dureté, pères majoritairement absents dans l’affectivité et la parole sensible, eux-mêmes ainsi éduqués.
Ces pères «extérieurs» abandonnaient leurs fils aux mères qui, par ailleurs s’en emparaient dès leur naissance puisqu’elles avaient un accès direct au corps du bébé. «La conséquence, explique Guy Corneau, est la peur des femmes et surtout la peur d’en être une». «La peur d’être une femme» est la première peur que doivent sans doute affronter les hommes en évolution. Elle est d’autant plus importante à comprendre que ce qui est demandé aux nouveaux hommes, c’est d’intégrer le principe féminin en eux, c’est de «vivre leurs qualités féminines». C’est à ce seul prix que pourront être abandonnées les images d’antan dont eux-mêmes sont fatigués. Car ils en ont assez d’être relégués et figés dans des représentations d’Epinal, que ce soit le héros, le bon père de famille, ou le séducteur. Ils en ont assez de rouler des mécaniques et de restreindre leur personne à leur sexe. Plus aucun homme en évolution n’adhère à ces images, même si elles sont générées de façon encore omniprésente dans les médias. Il en est de même des femmes qui, elles aussi, sont largement objetisées dans des images de mère idéale, de vamp ou de battante.
Petite histoire des caractéristiques féminines et masculines…
La masculinité, dans ce début de xxIème siècle, est redéfinie. C’est l’intégration des caractéristiques féminines qui fait accéder l’homme à sa propre plénitude. La plénitude d’être humain qui est la seule qui vaille.
«Intégrer le féminin», c’est vite dit. Mais que sont-elles, ces caractéristiques féminines ? Sont-elles invariables ? En enfermant les femmes dans des caractéristiques soi-disant «féminines» et les hommes dans des caractéristiques soi-disant «masculines», ne risque-t-on pas tout simplement de reconduire les stéréotypes dans un autre discours ? Si l’emballage change, le contenu ne reste- t-il pas identique ? Comment échapper à ce piège ?
On peut légitimement se poser la question de l’élaboration des catégories féminines et masculines. Comment ont-elles été élaborées ? A partir de quels éléments ? Les travaux ethnologiques et anthropologiques postulent que les observations des premiers hommes se sont faites sur les liquides émis par les hommes et les femmes : le lait nourricier, le sperme, le sang menstruel, le sang, le liquide amniotique. La fécondation, la fécondité, la reproduction font également l’objet de constructions mentales. C’est sur ces données que s’est greffé l’imaginaire et que sont apparues des classifications symboliques. Le monde de l’homme et de la femme ont été et sont encore représentés très différemment. on est dans une pensée binaire où les caractéristiques masculines et féminines s’opposent.

Une classification hiérarchisée
Le masculin est représenté comme actif, sec, dur, chaud, mobile, extérieur, alors que le féminin est représenté comme passif, humide, mou, abstrait. A cela s’ajoutent, à l’époque moderne, des classifications psychologiques : l’homme est perçu comme abstrait et théorique, la femme comme concrète et empirique. L’homme est du côté de la transcendance, la femme du côté de l’immanence, l’homme est dans la culture, la femme dans la nature.
Ces caractéristiques ne sont ni négatives ni positives en soi, mais elles ont été hiérarchisées ! C’est là que le bât blesse. La valorisation se fait toujours au profit de la catégorie masculine, et la dévalorisation va à la catégorie féminine.
on voit alors arriver des termes connotés : la femme est fragile, sans forces, faible, et l’homme est fort, actif, direct, doué de ressources. Le chaud est davantage valorisé que le froid, le jour davantage que la nuit, la tête davantage que le corps…
Cette classification en termes hiérarchisés entraîne d’immenses conséquences. L’homme a été très loin dans l’isolement à cause de cette coupure d’avec une partie de lui-même. L’homme s’est coupé de son appartenance à l’humanité en asservissant d’autres êtres humains tout au long de son histoire. Les femmes essentiellement. Le temps de la réconciliation est-il en train d’advenir ? Nous l’espérons. Les signes en sont nombreux, mais non encore fermement implantés. Les résistances séculaires font rage contre cet ordre nouveau. Pourtant, il y va de l’avenir et de la viabilité sur la terre. Car non seulement l’homme s’est coupé d’une partie de l’humanité, mais il s’est coupé dans la même logique, de la planète qu’il a pillée et exploitée à outrance pour son seul profit.
La sonnette d’alarme est tirée. Les sommets, congrès, options politiques écologiques se multiplient. L’urgence d’un revirement est manifeste. Le pouvoir constant du masculin sur le féminin est remis en cause par la révolution que représentent les hommes et les femmes en évolution. En évolution ensemble et séparément. Puissent ces hommes et ces femmes devenir majoritaires. Car cette véritable révolution est, ne nous y trompons pas, une des bases essentielles d’évolution spirituelle et sociétale du xxIème siècle.
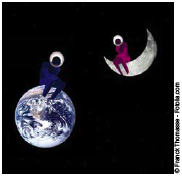
On est homme quand….
Parce que l’éros est en jeu, avec son cortège de projections et de rêves, avec son intensité aussi et sa profondeur, la façon dont est intériorisée la sexualité est essentielle dans ce processus de redéfinition du masculin. L’homme s’est bel et bien défini comme homme à partir de son sexe. La femme était considérée comme faible, vulnérable, fragile. Il importait donc pour l’homme que lui, le sexe «fort», ne soit pas assimilé à une femme. Cela va même plus loin : l’homme s’est non seulement défini à partir de son sexe, mais il s’est identifié à son sexe, et ceci en opposition à la femme dont le sexe est «faible» : «on est homme quand on n’est pas une femme»2
Dès lors, reconnaître et intégrer ses propres qualités féminines est un vrai défi. Car il s’agit de se confronter et de faire face à un legs transmis de générations en générations.
Si «on est un homme quand on n’est pas une femme», alors la peur d’être pris pour une femme est très profonde. La conséquence logique en est une autre peur, aliénante et ressentie par tous les hommes : celle d’être pris pour un homosexuel. Ce n’est pas tant le fait d’aimer ou de désirer un autre homme qui produit ce rejet, mais c’est le fait d’être pris pour un homme passif que l’on pourrait assimiler à une femme.
Pour la plupart des hommes, qui vivent encore la sexualité sous sa forme hétérosexuelle comme l’emblème et la preuve de leur identité d’homme, l’homosexualité reste donc fondamentalement problématique. «Aux yeux de certains, le seul fait de ne pas être homosexuel est déjà une assurance de masculinité », dit Elizabeth Badinter. Cela reste encore vrai pour beaucoup…. Le «coming out» actuel des homos n’y change rien.
Ceci a des conséquences très graves. La peur de l’homosexualité semble être une des causes les plus importantes qui ont empêché les pères d’antan [et encore trop souvent de maintenant] de toucher leurs fils. Fils qui sont en manque du contact avec le père. Il y a, dit la psychanalyste Annette Fréjaville, citée par Corneau, entre le père [ou son représentant] et le fils une «histoire d’amour» du garçon-bébé afin que le garçon puisse plus facilement trouver ses repères d’homme à venir. Elisabeth Badinter, elle, affirme : «Ne sont bons parents que ceux qui savent jouer de leur bisexualité».
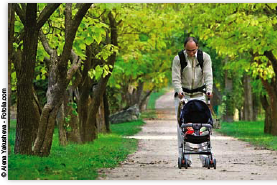
Des hommes capables de «paternage»
Une précaution : on a beaucoup glosé sur les conséquences de l’absence de père. Il ne faudrait pas stigmatiser les fils, nombreux vu le grand nombre de divorces, qui sont dans ce cas de figure. Déjà en 1980, un résumé des controverses sur le sujet, fut réalisé par Michaël Lamb3, et la conclusion en est que le père absent ne donne pas nécessairement des fils à problèmes ! Comme quoi, une fois de plus, il n’y a aucune vérité absolue en quoi que ce soit.
Ceci dit, c’est le nouveau rapport à la paternité qu’ils institueront qui fera que les nouveaux hommes existeront réellement. Et cela advient. Car les jeunes pères ont envie d’être là, présents. Ils se montrent attentifs à leurs bébés et à leurs enfants. Nous les voyons tous les jours à l’oeuvre.
Qu’est-ce qui différencie réellement les «nouveaux pères» ? Ce qui est nouveau, c’est le rapport aux soins à l’enfant. Les pères en évolution mobilisent leur capacité au «maternage». Le mot «maternage» dans ce cas n’a d’ailleurs plus lieu d’être. Pourquoi ne pas utiliser le mot «paternage» tout simplement ? Il existe des différences entre les mères et les pères dans leurs soins aux tout-petits. Les hommes sont tout aussi capables que les femmes de changer les couches, donner le bain à bébé, le nourrir au biberon, le mettre au lit, l’habiller [cfr «Autrement» n°72]. Nombre de pères le font. Une constante du paternage : les pères s’adonnent davantage aux jeux tactiles et bercent beaucoup leurs enfants.
Mais pour que cette nouvelle paternité ait réellement lieu, les images traditionnelles de virilité doivent être éradiquées. on en revient à la peur de l’homosexualité qui fait écho à «la peur d’être une femme» que nous évoquions plus haut...
Bon nombre d’hommes n’expriment pas leurs émotions et ne montrent pas leur sensibilité, assimilées à une caractéristique féminine, des fois qu’ils pourraient être pris pour une «chochotte», une «tante», une «folle » [notons en cela qu’ils restreignent l’homosexualité qui est, comme toute sexualité, plurielle…].

Les paroles d’hommes
heureusement, les hommes en évolution n’assimilent pas l’expression de la sensibilité à un déni de la masculinité. Mais il n’en reste pas moins qu’il y a un «silence masculin» à briser. L’on ne peut qu’encourager le d é v e l o p p e m e n t des groupes de paroles d’hommes, créé au départ par Guy Corneau, et des réseaux d’hommes. Ainsi, le RhB, le «Réseau Hommes Belgique» dont la belle devise «Le masculin en mouvement » fait écho au souhait «d’apporter une contribution à l’émergence d’une masculinité consciente et responsable».
Ce réseau fonctionne par la création de groupes d’hommes, ce qui permet de «créer un contexte où chacun peut vivre sa masculinité d’une manière authentique parmi d’autres hommes. Chaque membre pourra y développer sa capacité à s’exprimer et à construire son autonomie dans un contexte harmonieux ».
Le Réseau Homme Belgique (RHB) sur la RTBF
La féminité de l’un n’est pas celle de l’autre…
Dans le fait de vivre sa masculinité d’une manière «consciente et responsable » entre évidement le rapport à ses propres dimensions féminines auxquelles nous avons déjà fait allusion. Il est cependant important de re-questionner et d’approfondir ce concept. En effet, on retombe vite dans des images idéales et toutes faites si l’on ne tient pas compte de l’histoire de la personne. Les caractéristiques féminines de l’un ne seront pas les caractéristiques féminines de l’autre. Un exemple. Prenons deux hommes. L’un, Bernard, a eu une mère tatillonne, froide, soucieuse de bien faire et responsable. L’autre, Michel, a eu une mère chaleureuse, hyperémotive, bohème et souvent absente de la maison. Il est évident que le «féminin» de Bernard et le «féminin » de Michel seront différents. Car la femme intérieure [l’anima] des hommes est construite par la mère et tous les modèles féminins véhiculés par l’entourage proche.
Dans le couple, un phénomène de projection est à l’oeuvre. La partenaire réelle n’est pas du tout pareille à la femme intérieure de Bernard ou Michel. La partenaire a envie d’être aimée pour elle-même.
Il est donc essentiel de déterminer quelle est sa «dimension féminine», comment elle se caractérise. Lorsqu’on parle de «vivre sa féminité» ou de «vivre sa masculinité», il s’agit aussi de rendre conscient quelles images nous avons intériorisées de la masculinité et de la féminité. Si c’est une voie difficile, car elle demande un travail de conscientisation important, c’est pourtant une voie qui a l’avantage de n’exclure personne. L’homme et la femme peuvent effectuer cette démarche.
Un meilleur être humain
Bien qu’encore minoritaires dans le monde, les hommes en évolution existent. Et ils emportent heureusement de plus en plus le consensus de la société. Paradoxalement : être un homme actuellement, c’est pouvoir «vivre sa partie féminine» !
Bien sûr, les anciennes représentations patriarcales continuent à sévir. Elles sont profondément intériorisées et encore largement transmises, autant par les hommes que par les femmes. Il importe d’en être conscients et conscientes et de les éradiquer. Il importe d’arriver à ne plus fonctionner à partir seulement de ces rôles rigides de femmes et d’hommes. Il importe de se réconcilier et de se définir davantage en tant qu’être humain, que l’on soit de sexe masculin ou féminin, ayant une vie individuelle et spécifique à accomplir.
Il s’agit en fait d’intégrer toutes les dimensions de soi-même et de n’en exclure aucune. Il s’agit de ne pas être coupé intérieurement de l’autre sexe en soi. Encore une fois, intégrer sa masculinité ou sa féminité n’ont rien à voir avec une quelconque idée générale. Il s’agit toujours de vies individuelles, d’histoires individuelles. Il n’y a là rien d’abstrait.

Il s’agit tout simplement de devenir le plus complètement possible une personne qui tend vers sa complétude…
Un homme qui vit cette complétude est tout simplement un meilleur être humain…
Marie-Andrée Delhamende
1 Se reporter à Fr. Héritier pour les paragraphes qui expliquent les définitions du masculin et du féminin construites par les anciens.
2 Cfr. «XY de l’identité masculine».
3 The father’s role, Michaël Lamb, éd. Brown and Co [1980].
Livres
- F. Héritier, «Masculin/féminin», t1 et2, Editions Odile Jacob.
- E. Badinter, «XY. De l’identité masculine », Editions Odile Jacob.
- G. Corneau, «Père manquant, fils manqué», Editions de l’Homme.
- J. Arènes, «Lettre ouverte aux femmes de ces hommes pas encore parfaits», essais Fleurus.
Site
- Réseau Hommes Belge : www.rhb.be
Film

Le DVD du film “Le souffle du désert” en vente à la boutique, cliquez ici ...
Paru dans l'Agenda Plus N° 216 de Avril 2010

