Les vacances autrement
Avant, on ne partait pas. On n’avait même pas de congés. Maintenant, les vacances sont synonymes de voyage. Les médias nous mettent en contact avec l’autre bout du monde. On a envie d’y aller voir. On part. Oui, mais avec quelle formule ? Que nous propose-t-on ? C’est quoi, être touriste exactement ?…

Téléchargez ici la version du dossier au format PDF
Les vacances, nous l’oublions parfois, ont été obtenues de haute lutte. Au XIXème siècle, seuls les militaires et les fonctionnaires avaient droit à un congé. Les travailleurs, eux, ne bénéficiaient d’aucun arrêt de plusieurs jours. Les temps de travail étaient longs, et s’étalaient sur toute l’année sans discontinuité, ce qui, aux yeux des occidentaux de maintenant, est difficilement concevable. Actuellement, en Occident, le temps des vacances est devenu une façon de rythmer son année. Dans bon nombre de pays cependant, ne nous leurrons pas, le surrégime de travail est encore la norme usuelle, même si elle ne l’est pas dans les principes.
Il fallait éduquer le peuple …
Dans l’article 24 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 24 décembre 1948, il est stipulé que «toute personne a droit à des congés payés périodiques». On se trouve cependant encore dans le loisir, et pas dans les vacances telles que nous les entendons. Le loisir est, à cette époque, entendu comme un temps libre qu’il faut occuper. Pas question de laisser l’ouvrier à lui-même. «Il faut éduquer le peuple» : dans les années 30, c’est ce que pensent les catholiques, autant que les socialistes et les syndicalistes. Cette éducation du peuple ne va pas sans encadrement. Dès 1936, les syndicats se démènent pour organiser des excursions de groupe de travailleurs. Par exemple, en 1937, il y eut des cars pour visiter l’Exposition Universelle à Paris. Mais en règle générale, faute de moyens, on ne partait pas. Dans les classes dites laborieuses, on se distrayait comme ses pères et ses grands-pères : on allait au café. Là, on buvait, on jouait aux cartes, et surtout on rencontrait les autres. Nature, tandem et premiers villages de vacances… Le temps libre vit se développer le retour à la nature. Dès le 20 juin 1936, date où, en France, fut votée la loi des congés payés, on allait à la campagne en vélo ou en tandem, on pêchait, on pique-niquait. Les premiers campings et surtout le développement des auberges de jeunesse favorisait ces escapades dans la nature proche. C’est seulement dans les années ‘50 que les premières structures de vacances lucratives naissent, en provenance de Grande-Bretagne avant la seconde guerre mondiale. Ces premiers villages de vacances sont, en quelque sorte, l’ancêtre des villages de vacances, type Club Méditerranée.
Il fallut une vingtaine d’années pour que l’on assiste à un essor du tourisme proprement dit. En effet, durant les années ‘50, avec le développement économique de l’après-guerre, et la montée d’une classe moyenne plus aisée, on commence à partir en vacances. Jusque là, le tourisme était plutôt le fait d’individus fortunés. Au début du XXème, c’est l’Orient Express, les palaces luxueux, les croisières alanguies et festives sur des grands paquebots blancs. Ce sont les eaux à Baden-Baden, Venise en hiver, et la pureté des lacs suisses. «Luxe, calme et volupté» dirait le poète. Ou alors les voyages sont élitistes et éducatifs, comme ceux entrepris par les jeunes aristocrates d’Outre-Manche, fin XIXème siècle qui, tels les humanistes d’antan, partaient à la découverte des capitales d’Europe pour parfaire leur éducation. Le tourisme était donc l’apanage d’une classe riche. Dans les années ‘50, il devient accessible à un plus grand nombre. Le tourisme de masse naît et se développe.

Un milliard six cent mille touristes
Dès les années ‘90, l’industrie du tourisme est la troisième industrie mondiale. D’ici 2020, estime l’Organisation Mondiale du Tourisme, les touristes atteindront le chiffre pharamineux d’1,600 milliards de personnes. Là où les classes moyennes émergent et où les moyens financiers suivent, le touriste fait son apparition. Les Chinois, les Coréens, les Brésiliens, les Indiens, les Russes voyagent. Le tourisme devient un des visages, et non des moindres, de la mondialisation.
Les salariés disposent d’une vingtaine de jours de vacances par an. Etrange activité humaine que celle de s’offrir dans un laps de temps relativement court un voyage dans une région du monde inconnue, de préférence lointaine. Activité qui n’est pas toujours bien assumée par ceux et celles qui la pratiquent. On a mauvaise conscience à se dire touriste. Sans doute, le touriste sait-il confusément que son passage demande des aménagements. Que les paysages se façonnent en fonction de sa demande. Que son arrivée ne laisse pas la nature et la culture intactes. Est-ce nécessairement à vilipender ? Encore une fois, il faut nuancer. Sans tourisme, dans le modèle économique qui est le nôtre actuellement, basé sur l’offre et la demande, ce serait l’effondrement économique de certaines contrées ou de certaines villes comme Florence, Bruges, Venise.
Renouvelé par d’autres horizons
Ceci dit, pourquoi partir, après tout ? La personne en vacances pourrait aussi choisir de ne pas partir et rester chez elle. Quel est donc le bénéfice ?
Comme l’enfant qui grandit grâce à de multiples stimulations sensorielles, l’adulte a également besoin de stimulations. Quoi de mieux que de découvrir d’autres modes de vie dans d’autres environnements ? On rompt avec les habitudes et cette rupture est riche car elle nous introduit à d’autres dimensions de nous-mêmes.
Curieux temps que celui des vacances qui, étymologiquement, signifie «oisif, absent». On s’absente de sa vie quotidienne. Les vacances dépaysent, c’est bien connu. Grâce à ce dépaysement, il est possible de revenir chez soi avec le regard renouvelé par d’autres horizons, d’autres visages. C’est ce que vivent bon nombre de personnes qui font un voyage hors Occident durant un temps prolongé. Il s’agit alors d’un véritable voyage initiatique. Des véritables vacances, en quelque sorte, où la personne s’offre à «la» vacance, dans le sens d’être vacant, disponible à ce qui vient au fil des jours….
Rêves, soif de beauté et porte-monnaie
Vers quoi partir ? Peut-être vers son rêve… C’est, en tous cas, ce que les voyagistes offrent et fabriquent à profusion : du rêve. Mais c’est un rêve qui se paie, et parfois cher.
Supposons que notre touriste soit urbain, dans la petite quarantaine, salarié, en couple, sympathique, curieux, ouvert, aimant découvrir d’autres cultures. Quel est son rêve, à lui ?
Ce dont il a envie, c’est d’aventure et de nature sauvage. Ce dont il a envie, c’est de ne pas se faire le complice des dégâts causés par la société riche et industrielle (dont il est paradoxalement un des dignes représentants), dégâts écologiques notamment. La contradiction, c’est qu’il pousse la porte d’une agence de voyage, et qu’il y paie son rêve : on lui propose une marche dans une nature «sauvage» avec haltes auprès de peuples préservés.
Les mots du rêve sont tous là : une nature sauvage, des grands espaces, des peuples préservées. Les séjours «tout inclus» n’ont pas la côte chez les touristes qui veulent voyager «intelligent». En revanche, les nuits à la belle étoile sous le sac de couchage, les bivouacs en pleine nature, oui. Ce n’est pas blâmable, loin de là. C’est même plutôt positif, et bon pour les âmes qui ont soif de beauté, que de se recharger en visions de nuits étoilées.
Ce qui est étonnant, c’est que les vacances à la dure, où l’on porte 15 kilos de sac à dos, ça coûte ! Nous en sommes donc arrivés à une forme d’aberration qui consiste à devoir payer notre besoin de vivre plus sobrement….

Le tourisme-Disneyland
Tout est possible dans cette gigantesque offre de l’industrie du tourisme et il importe de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. C’est à la lucidité qu’exhorte Sylvie Brunel, auteure et géographe. Suite à un héritage, elle partit faire le tour du monde, avec mari et enfants. Ce qu’elle raconte est de l’ordre du tragi-comique et démontre, en tous cas, le paradoxe dans lequel se trouve pris le touriste en quête de lieux autrefois inaccessibles… Pour les découvrir, ces endroits exotiques et lointains, le touriste accepte que le rideau se lève sur un décor bien huilé. De l’exotisme, il y en a, mais scénarisé. Ainsi, en Nouvelle Zélande, il y a des geysers. Mais il y a en un qui jaillit à heure fixe ! En Polynésie, au lieu de s’ébattre librement dans le fond sous-marin soi-disant paradisiaque mais en réalité abîmé, car surexploité, les touristes sont dirigés vers une seule et unique lagune préservée…
Sylvie Brunel prévient très justement : «Le tourisme disneylandise le monde, transformant les milieux d’accueil en une succession de parcs à thèmes, où le touriste doit pouvoir retrouver un passé recréé ou préservé en toute sécurité». A Disneyland, on trouve des petites niches où le monde d’un personnage est recréé. Il y a le monde de Mickey, du roi Lion, d’Ali Baba, etc... C’est à peu près la même chose pour le tourisme. Niche tourisme de loisir : une pléthore de stages créatifs et autres vous sont proposés. Niche tourisme culturel : vous découvrez les sites historiques. Variante ethnotourisme : vous rencontrez des peuplades authentiques. Niche tourisme sportif : du mountain bike dans les Alpes au ping-pong dans les îles Fidji.
Rêves d’aventure…pourvu qu’on soit lucide !
Il suffit de parcourir les intitulés des catalogues. On se rend compte rapidement que l’industrie du tourisme bosse ferme pour offrir de nouveaux produits de plus en plus sophistiqués pour rencontrer les rêves. Les rêves de qui ? On aurait envie de répondre : les rêves des grands enfants de la société de consommation. Logique que dans cette surabondance de biens matériels, il faille du rêve pour survivre. Rêves d’aventure de quand on était petit : on peut se transformer en plongeur des grands fonds, devenir explorateur dans les contrées sauvages aussi fameuses que l’Amazonie, sauter avec des parapentes dans les précipices, surfer sur des vagues géantes, se retrouver en tête-à-tête avec des troupeaux d’éléphants. Question : le tourisme est-il en passe de devenir un immense «jeu de rôle où s’organise une sorte de régression infantile de l’être occidental» ? (ibid)
Ceci dit, si l’argent n’est pas un problème et que sauter en parapente dans un précipice apporte à la personne ce qu’elle cherche, alors go ! Pourquoi pas ? Pourvu qu’on sache ce que l’on fait. Tout choix conscient et assumé est respectable. Affronter le danger, mesurer son courage, relever un défi personnel, se préparer physiquement et psychiquement à vivre une expérience aventureuse peut s’avérer extrêmement riche et positive pour la personne qui fait ce choix. Pourvu qu’il n’y ait pas leurre sur ce que l’on vit. Pourvu que l’on ne soit pas la victime inconsciente d’une immense machine à consommer. Victime non. Partie prenante, oui. Si c’est le type d’expérience qui convient à la personne.
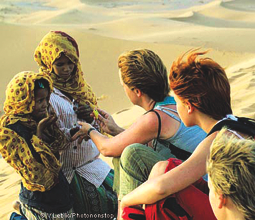
D’authentiques tribus…
Le tout est de rester vigilant par rapport à l’offre. Dans les voyages ethnotouristiques, le touriste est en contact avec des populations locales préservées. Il rencontre d’authentiques groupes africains, par exemple. Lors de son périple organisé, une rencontre est prévue avec ces groupes, rencontre dans leurs lieux de vie, dans leur habitat. Ces africains, vêtus de pagnes et maquillés, dansent… Dans bien des cas, les ethnotouristes sont des personnes cultivées et respectueuses, inutile d’avoir mauvaise conscience. Mais ayons au moins conscience tout court de ce qui se passe réellement : s’il y a «rencontre» entre le touriste et l’habitant, il faut quand même se dire que c’est une rencontre d’un type spécial, puisqu’elle tourne autour de l’argent. En outre, il reste aussi à se poser la question de savoir s’il n’y a pas, de la part des voyagistes, tout intérêt à ce que les groupes en question restent soi-disant authentiques. Factice authenticité mise en exergue quand elle devient un argument commercial.
Rendez à César…
Factice dans la mesure où les groupes en question intègrent des données extérieures à leur culture, ne fût-ce que par le biais des rencontres avec les organisateurs, et les touristes eux-mêmes. Bref, il y a une forme d’acculturation imposée qui ne correspond pas nécessairement au rythme de changement identitaire de ces minorités. C’est la réflexion que se fait O. Paquet-Durant, de la Commission Internationale pour les Droits des Peuples Indigènes : «personne n’a le droit d’envahir leur environnement et de perturber le fragile équilibre écologique qu’ils sont les seuls à savoir gérer et qui leur est vital».
Pour éviter cet écueil, la solution consisterait à arrêter toute activité touristique dans ces régions, ce qui serait sans doute le plus sain, mais irréaliste. L’autre voie est de rompre avec un tourisme qui soit coupé de la réalité de ces minorités. C’est à elles qu’il appartient de réaliser les projets touristiques et d’en toucher les bénéfices. Des formes d’ethnotourisme respectueux existent, elles impliquent les ethnies elles-mêmes de la conception à la réalisation du projet. En Basse-Casamance au Sénégal, c’est la population locale qui construit et qui gère les hébergements pour touristes.

Un contrat en bonne et due forme…
C’est ici qu’intervient peut-être, de façon la plus pertinente, la notion de tourisme équitable. Le tourisme équitable est une démarche qui mérite d’être soutenue en ce sens qu’elle prend en compte chaque personne qui participe au projet. Des engagements sont pris entre les organisateurs locaux, les touristes, et les associations de voyages alternatifs. Chacun est rendu à sa responsabilité, et cela dans la transparence.
Plusieurs associations sont engagées dans le tourisme équitable. Ici, l’objectif n’est plus de créer un produit standard. On fait avec ce qui existe, et non pas seulement en fonction des desiderata d’un touriste-roi. Ce qui importe dans cette approche, c’est de valoriser ce que les personnes savent faire. Ainsi, on réinjecte les bénéfices dans les activités qui permettent une amélioration globale de l’environnement socio-économique local.
Le tourisme équitable fait tout simplement appel à l’honnêteté et au bon sens. Tout travail mérite salaire, dit le proverbe. Ce proverbe, si nous l’employons pour notre propre job, pourquoi ne serait-il pas valide dans les pays lointains ? Il est normal qu’un accord et donc un contrat soit passé avec les personnes de l’ethnie rencontrée. Contrat où est indiquée une rémunération juste qui tienne compte du travail fourni et des besoins réels de la personne, ainsi que les conditions et la description du travail. Ces engagements sont tout simplement de l’ordre du respect des droits élémentaires de chacun.
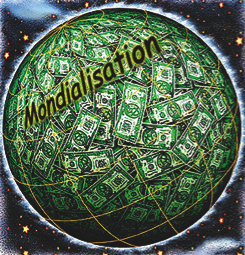
Touriste passif ? non, merci
Les associations de tourisme équitable s’engagent également à informer le touriste et à accepter le contrôle sur le respect des principes du tourisme équitable, et cela à chaque étape du processus. Ce n’est pas rien, cette transparence. Le touriste n’est pas simplement passif, il peut, s’il le veut, connaître le fonctionnement de l’association et la façon dont est géré le voyage auquel il participe. On lui rappelle que le voyage n’est pas un produit innocent. En effet, le touriste a un impact direct sur les personnes du pays qu’il visite. D’où l’intérêt de tendre à devenir un voyageur responsable, si l’on est sensible à cette problématique.
Voyageur responsable, consommateur responsable, ce n’est pas toujours très réjouissant, se dit-on. Responsable. On se surprend à souhaiter être guidé dans nos vacances. Guidé, peut-être. Mais l’industrie du tourisme à tendance à trop souvent infantiliser. Vu que le tourisme est une activité économique qui a une expansion hors du commun, la notion de tourisme équitable devrait s’appliquer à toute forme de tourisme, qu’il soit d’aventure, culturel, de loisir, sportif…En attendant, si l’on préfère voyager par le biais de voyages organisés, on peut déjà faire des choix en privilégiant et recherchant plutôt des associations de tourisme solidaire et équitable.
Etre responsable, c’est déjà essayer, un minimum, d’être conscient de ce que signifie le fait d’être touriste une fois l’an. Et c’est peut-être plus simple qu’on ne le pense. Il y a d’abord l’information et la réflexion. Les moyens ne manquent pas. Les livres. Internet. Les amis. Le plus aisé et sympathique, c’est parfois d’organiser son voyage individuellement et de se faire conseiller et guider par des amis, ou des connaissances bienveillantes qui ont déjà une expérience du pays visité. Bienheureux échange que celui-là, lorsqu’il est possible.
Tu loges chez moi ?
Hébergements chez l’habitant, à la ferme, ou dans des gîtes respectueux de l’environnement, il y a le choix en quantité et en qualité. Il suffit de chercher. Une autre formule tout à fait intéressante : choisir un logement qui favorise l’insertion dans la réalité d’un autre que soi. C’est ce que permet l’échange de logements. Cette formule date des années ‘50. Il s’agit de prêter sa maison ou son appartement pendant une période donnée à quelqu’un qui fait de même pour vous. On peut aussi prêter son auto, si on le souhaite. Riche expérience de confiance mutuelle. Et aussi de partage. Sans se rencontrer nécessairement par le biais d’une rencontre physique, on se rencontre par les lieux. Par les façons différentes de vivre dans une maison, dans un village, une ville, un environnement.
Certains se méfient de cette formule, craignant les dégâts que les invités pourraient causer. C’est légitime : si on prête son appartement ou sa maison, on a envie de les retrouver intacts. On a envie que les personnes qui vont y trouver accueil respectent notre lieu. Mais suivant en cela le principe très sain de se comporter chez l’autre comme on aimerait qu’il se comporte chez soi, l’échange se passe généralement très harmonieusement.
Volontaires nature et ferme bio
Certains passent leurs vacances au loin, au vert, gratis, instructif... et utile. Ce sont les volontaires. Ce n’est pas encore très répandu dans le grand public. Mais des volontaires pour la nature sont envoyés aux quatre coins du monde, et se mettent au service des associations, avec le soutien de WWF. Quelques exemples : protection de la faune sauvage en France, la protection de la forêt de montagne en Suisse, revalidation des tortues en Italie. Les volontaires sont sélectionnés sur base de candidature.
Plus ciblé, les volontaires dans les fermes biologiques. Ceux-ci sont appelés des «Wwoofers» du terme «woof» qui signifie «Working Weekends on Organic Farm», que l’on peut traduire par travail de week-end dans les fermes biologiques, pratique née en Angleterre en 1971. Le Woofer est un volontaire adulte qui se propose de travailler volontairement dans l’agriculture biologique. Contre ce travail, on lui propose le logement et la nourriture gratuits. Lui, il acquiert une riche expérience sur le tas. Il dispose de suffisamment de temps libre pour découvrir la région et se reposer. Ce sont donc des vacances actives. Le wwoofing se pratique dans le monde entier. L’Australie est très friande de ce type de pratique puisqu’ils sont 2000 par mois à être lancé par l’association. L’association est internationale et compte de nombreux pays, dont des nouveaux venus comme la Turquie, la Slovénie, le Mexique…
Invité…
Dans le rapport à la nature, une mention particulière pour l’écotouriste qui met en pratique les principes de «durabilité» mentionnés ci-dessus. Ce qui distingue l’écotourisme, sa spécificité, c’est qu’il est, comme son nom l’indique, axé sur la nature et respectueux d’elle. Voyager est une grande école. Une école du regard avant tout. Le regard porté sur soi-même change lorsque l’on se regarde d’ailleurs. Les problèmes, décontextualisés, deviennent relatifs. L’essentiel émerge. Que cette école soit avant tout considérée comme lieu où le touriste est invité. Car invité, il l’est. A lui donc de se plier de bonne grâce aux us des personnes qui l’accueillent. Tout en se sachant issu d’une culture occidentale qu’il ne renie pas -car elle a aussi ses valeurs et ses beautés-, à lui de ne pas se comporter en mini-colonisateur. Puissent alors nos regards s’enrichir l’un de l’autre, puissent les vacances être déjà l’acceptation dans nos vies du grand métissage qui accouche du monde de demain et le compose.
Marie-Andrée Delhamende
(1) Commission Internationale pour les Droits des Peuples indigènes
Livres et contact - «La planète disneylandisée», Sylvie Brunel, Editions Sciences Humaines, 2006.
- «Le guides des vacances écologiques 2006-2007», Editions du Fraysse.
- Tourisme et développement solidaire, 00 33 241 25 23 66, www.tourisme-dev-solidaires.org
- Sites sur le tourisme alternatif : tourisme-solidaire.uniterre.com & http://biovacances.net
Paru dans l'Agenda Plus N° 186 de Avril 2007

