Vivre en ville autrement
Nos villes nous ressemblent. On l’oublie trop souvent. Elles sont un reflet des époques, des cultures, de nous-mêmes. QueI miroir nous tendent-elles aujourd’hui ? Comment habitons-nous en ville ? Où est la place des autres ? Que faisons-nous avec nos villes ? Pourquoi les fuyons-nous ? Que pouvons-nous faire ?...

Téléchargez ici la version du dossier au format PDF
Dès l’antiquité, les villes sont des centres qui représentent la quintessence des civilisations qu’elles expriment. Ce sont Babylone et Ninive, entourées d’enceintes. C’est Athènes qui se dote de la première constitution donnant ainsi naissance à la notion de citoyen. C’est Rome de laquelle partent des routes aux quatre coins de l’Europe.
Au Moyen-Age, les marchés se multiplient et les banques apparaissent dans le bourg… habitées par des «bourgeois », qui sont de riches commerçants. Les villes ont alors une fonction d’échange économique. Avec la Renaissance, les préoccupations sont d’ordre esthétique : le souci de l’architecture et de l’urbanisme est omniprésent. Quant à la période classique, période de symétrie, elle privilégie un modèle géométrique où l’ordre domine.
De plus en plus grande
Avec l’essor des industries, tout change : la ville grandit en surface et en population, et cela de façon remarquable. Elle n’est plus fixée par des remparts, comme par le passé, mais elle s’étale, elle déborde. Les limites en sont floues. Ttout change en effet, à cause de l’apparition au 20ème siècle de l’automobile qui modifie tous les paramètres d’accès et de sortie de la ville.
Les grandes villes se peuplent, leur population s’accroît. Oon connaît l’image de ces villes asiatiques immenses, bâties en hauteur comme Hhong Kong, ou tentaculaires, s’étalant parfois sur des kilomètres, comme la plupart des grandes villes américaines. Les villes européennes ne sont pas encore à l’image de ces dernières, encore que les entrées de ville européenne, à la française notamment, en ont certains traits les moins excitants… avec leurs grands centres commerciaux, leurs hypermarchés, leurs pancartes publicitaires gigantesques et criardes et leurs méga-parkings…
La ville à la campagne…
Ce qui caractérise le rapport à la ville actuellement est qu’on la fuit. La ville a mauvaise presse ; elle est devenue synonyme dans bien des têtes de pollution, de bruit, de stress. assiste de plus en plus à une fuite vers la périphérie verte. Quoi de mieux en effet que de jouir des plaisirs qu’offre la ville, en vivant à la campagne dans une maison quatre façades ? Dès qu’un couple a des enfants et qu’arrive la famille, les charmes de la ville dont s’accommodaient les vies solo ou duo, s’évanouissent comme fumée. Ce qui semble souhaitable par le plus grand nombre, c’est une famille unie, dans une belle et vaste maison à la campagne dotée de tout le confort, et sise pas trop loin de la ville. comprend que cette image idéale fascine....
Le retrait de la ville est devenu une aspiration de la plupart des ménages. La ville est de toute façon facilement accessible puisqu’on est motorisé. Les personnes motorisées s’affranchissent de la ville, d’où l’appellation désormais consacrée d’«urbanisme diffus ».
Un cruel paradoxe
«L’urbain diffus» cherche à habiter dans un paysage de type campagnard… mais il n’a rien d’un paysan. Ce choix a évidemment un coût. Ce sont les urbains riches qui émigrent vers la campagne. Les pauvres n’ont pas de voiture, ni les moyens d’acheter ni terrain ni maison. Ils restent donc en ville. Comme l’exprime Bernadette Mérenne, professeur de géographie économique à l’Uuniversité de Liège : «Les pauvres de la ville paient en partie les surcoûts [installations en électricité, égouts…] de l’urbanisation des nouveaux terrains des périphéries. Il faut faire payer les vrais coûts à la population de ces terrains. On doit mener une politique cohérente du coût-vérité».
«L’urbain diffus» aime la nature, c’est un fait, ou du moins aime l’environnement agréable qu’un habitat en périphérie ou à la campagne suppose. Mais cette aspiration donne lieu à un cruel paradoxe, comme l’explique A. Berque, directeur à l’Ecole des Hhautes études, géographe et orientaliste : «La quête de la nature, en termes de paysage, détruit son objet même : la nature en termes d’écosystème et de biosphère. Associée à l’automobile, la maison individuelle est en effet devenue le leitmotiv d’un genre de vie dont l’empreinte écologique démesurée entraîne une surconsommation des ressources naturelles».
Il est évident que l’empreinte écologique est moindre avec un habitat collectif et des transports en commun que dans une maison quatre façades avec une, voire deux voitures individuelles utilisées parfois quotidiennement aux fins de déplacements pour travailler en ville…

La ville renouvelée sur elle-même
Le rêve des citadins, en termes d’habitat, est un rêve d’habitat vert et dispersé. C’est un fait que, verte ou non, la périphérie de la ville s’étend de façon de plus en plus colonisatrice. La «périurbanisation» bat son plein.
A tel point que c’est devenu une préoccupation importante des architectes et urbanistes tenants du développement durable. Ceux-ci, pour favoriser une empreinte écologique moindre des habitants, promeuvent dans les années ‘80 le concept de «ville renouvelée sur elle-même». Il s’agit de limiter la surface des villes, ceci en réhabilitant des quartiers anciens, mais aussi en réaffectant des friches ou des zones industrielles existantes, comme c’est le cas dans le Nord de la France, avec les écoquartiers des communes de Roubaix, Ttourcoing et Wattrelos. A l’inverse des villes nouvelles qui «mangent» beaucoup d’espace, la ville renouvelée permettrait également, si elle est bien pensée, d’envisager une ville sans voiture. Mais elle nécessite un urbanisme réfléchi, étant donné la nécessité de réhabiliter des bâtiments anciens et d’en construire des neufs dans une ville déjà en activité.
Avec ou en dépit du monde ...
Si l’habitat en périphérie verte favorise le retour à une vie saine, à une nourriture saine, et à une forme d’harmonie non troublée par les divers inconvénients de la ville, il est aussi une expression inconsciente du clivage et de la ségrégation à l’oeuvre dans les villes. Ce clivage frise la folie aux USA où des centres commerciaux colossaux, voire des villes, sont artificiellement construites par le secteur privé. Dans ces îlots, coupés de la réalité, pas de droit constitutionnel. La seule loi qui prime est celle de l’argent. Oon assiste là à un renversement : «Ce n’est plus l’espace public qui enchâsse un espace privé en expansion, mais un territoire privé qui abrite et régit des activités autrefois publiques», comme le dit Mona Chollet dans un édito du Monde Diplomatique [n°114] très pertinemment intitulé «Utopies dévoyées». Ooui, la belle notion d’utopie avec ses forces avant-gardistes et expérimentales est dévoyée lorsqu’elle donne lieu à un repli frileux sur soi-même et à une coupure d’avec le monde extérieur.
Les enclaves idylliques, quelles qu’elles soient, se positionnent non pas avec le monde et l’écologie planétaire, mais dans le déni, pourvu que leurs habitants y vivent confortablement.
Dans la même logique d’un espace fragmenté, et de la création d’îlots, Henri Lefebvre [1901-1991], philosophe et sociologue, auteur de «Critique de la vie quotidienne» dit : «Bientôt, il ne restera plus à la surface de la Terre que des îles». Pas folichon. Mais d’ajouter tout de suite : «D’où l’importance des questions écologiques : le cadre de vie passe au rang des urgences... Il faut restituer la place à la vie associative et à l’autogestion, qui prennent un autre contenu dès qu’elles s’appliquent à l’urbain ». En effet, la vie associative et l’autogestion en ville concernent avant tout des comportements.
Quotidiennetés
Il importe de bien comprendre que l’identité urbaine est composée de la façon dont est vécue la quotidienneté de chacun et la façon dont il vit le temps et l’espace. Le quotidien. ça paraît simple. Mais rien n’est moins simple que cela. Ttoutes les dimensions humaines sont mises en oeuvre dans la vie au quotidien en ville. De la physiologie, et c’est notre besoin de faire pipi-caca en ville et la façon dont sont conçues les toilettes publiques, s’il y en a, ou encore la façon dont sont aménagés les espaces pour les handicapés ou les mal-voyants. De la morale, et c’est la façon dont l’anonymat est préservé dans la grande ville, où l’on peut davantage s’adonner au poly-amour, si c’est notre vie et notre bonheur, que dans le terroir profond ! De l’esthétique, et c’est la beauté d’une place réaménagée ou sa laideur ; c’est l’espace public, qui nous ravit ou nous agresse chaque matin quand nous empruntons le même trajet pour aller au boulot. Et la liste pourrait s’allonger sans fin…Aucune dimension de notre quotidien n’échappe. Notre quotidien est investi par le «comment on vit» dans notre rue, notre quartier, notre ville. Aussi, chacune de ces dimensions peut-elle être questionnée par une réflexion écologique et citoyenne. On est citadin, on réfléchit au comment on est citadin, et on devient alors citoyen. L’écologie urbaine postule une interdépendance entre le citadin et son environnement urbain. Il s’agit donc de questionner ses transports et sa consommation, mais aussi ses relations aux autres.
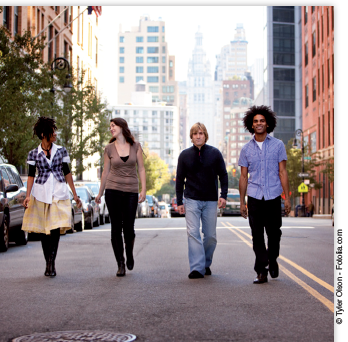
Ville durable = ville solidaire
Il ne s’agit pas de créer des villes durables couvertes de panneaux solaires et d’éoliennes urbaines, au réseau de transport en commun l’enmodèle si les gens sont clivés dans des quartiers sécurisés, et si le pouvoir d’achat ne se trouve qu’aux mains de quelques-uns. On ratera l’objectif : donner la priorité à l’humain. Tout fonctionne ensemble.
>>> Voir la suite des épisodes ...
S’il est bien un défi et un enjeu dans le développement durable dans la cité, c’est en effet celui de la mixité. Uune ville durable est d’abord et avant tout une ville solidaire. ville qui pense ses espaces et ses quartiers comme des espaces où il est possible de se rencontrer. ne peut se rencontrer que dans la mesure où il existe des espaces conçus pour la rencontre, autrement dit des espaces où il fait bon vivre pour tout le monde. Certaines villes font ces choix. La ville de Nantes en France a été repensée en fonction du critère de la rencontre et des liens sociaux. Concrètement, cela signifie que les espaces d’échange sont privilégiés : les jardins collectifs, les espaces verts, les espaces culturels comme la médiathèque et les lieux dédiés à la création et aux expositions. Le tissu social d’une ville, c’est sa vitalité. La ville, ce sont d’abord et avant tout un ensemble d’humains qui essayent de trouver des manières de vivre ensemble dans un espace particulier.

Flexibilité et nomadisme, frein à l’engagement ?
Ceci dit, il importe de comprendre que le rapport à la ville change, ainsi que le rapport à la solidarité et à l’engagement envers et avec autrui, parce que les conditions du travail en ville se sont modifiées. Le travailleur doit être «flexible». Flexibilité suppose fluidité, souplesse, rapidité, changement, créativité, mais entraîne aussi le nomadisme, la précarité et l’insécurité. La mobilité est grande chez les travailleurs flexibles, les intérimaires, les contrats de courte durée. Oon déménage beaucoup. Par ailleurs, les bureaux eux-mêmes doivent présenter ce caractère flexible, ils doivent pouvoir être rapidement réaménagés. Bref, on ne s’attache plus à un lieu, puisqu’il est impensable d’y rester longtemps et de s’y engager à long terme. Mais cette flexibilité, qui pourrait être une belle valeur si elle n’était un des fers de lance de la mondialisation, a des revers : elle favorise le désengagement de la vie dans la cité. La participation civique demande de l’engagement, du temps et de l’énergie, et ce n’est vraiment pas donné, comme le montre l’enquête du sociologue Richard Sennet, auteur de «Les conséquences humaines de la flexibilité».
La ville hospitalière…
Pour vivre sa citoyenneté dans la ville, pour vivre ensemble, il faut être «planté » quelque part. C’est un des défis de la vie en ville : on loge dans tel quartier, on fait ses courses dans un autre, on travaille dans tel autre, les enfants sont dans une école ailleurs, et on court, on court…
Ceci dit, cette mobilité, qui est une des composantes de la ville, n’a pas détruit une de ses principales richesses : la ville met en contact, la ville a des lieux où l’on se rassemble ! La ville a quelque chose d’hospitalier. Mais oui. Bien davantage que la vie au village, qui supporte mal le hors norme et la nouveauté. Et c’est parfois aussi simple posque cela, d’être citoyen : parler avec quelqu’un, discuter au lavoir, à l’école, dans une chorale, une association de parents, émettre des idées, mettre sur pied des projets. Bref, être ou faire quelque chose ensemble. Qui dit vie dit mouvement, changement, adaptation. Adaptation en fonction du présent et du futur. Prise en compte des données qui ne cessent de nous arriver de partout, nous donnant mille raisons de tenter d’autres formes de quotidienneté. Seul, il semble que ce soit extrêmement difficile. Mais avec autrui, c’est envisageable, pourvu que de puissantes motivations y soient !
«Villes en transition»…
Les motivations ne manquent pas aux personnes qui font partie du mouvement «Villes en transition», né en septembre 2006 en Grande-Bretagne, et qui, depuis lors, a pris le nom d’«Initiatives de transition », vu qu’il peut s’appliquer à une ville, mais aussi au quartier d’une ville, à une commune ou à un village. Il existe actuellement plus de 250 initiatives de transition dans une quinzaine de pays, essentiellement en Europe et en Amérique. De quoi s’agit-il ? Primo : le groupe réfléchit ensemble à l’avenir de la vie en ville. Deuxio : dans cette réflexion, une prise de conscience sérieuse et motivante a lieu sur le rôle dans nos vies présentes et à venir du réchauffement climatique et des problèmes liés aux énergies fossiles qui se réduisent. Dans un avenir plus ou moins proche, il va falloir, semble-t-il, trouver les moyens de vivre avec ces nouvelles données qui entraînent inéluctablement des modifications que la plupart d’entre nous ne peuvent pas intégrer profondément. Bref, il va falloir être «résilient»…
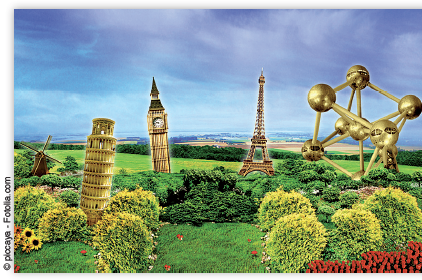
En se groupant…
Etre résilient est une façon de réagir positivement aux crises. Les tenants du mouvement «Villes en transition» ont analysé la dépendance de notre société au pétrole qui, soutiennent-ils, est semblable à une dépendance toxicologique. La lutte contre cette dépendance peut se traduire en actions concrètes. Ce n’est pas à un individu de porter le changement. Seul, il est difficile de changer. Mais en se groupant, à l’échelon d’une communauté, on peut arriver à induire de nouveaux comportements et façons de vivre en ville, dans un arrondissement, etc.
Vers la «descente énergétique»…
Le fait est que la meilleure solution est peut-être de se préparer à vivre en consommant moins d’énergie, étant donné que, de toute façon, nous y serons obligés tôt ou tard. Oon parle à ce sujet de «pic pétrolier». Le pic pétrolier est la date à laquelle il ne sera plus possible de produire davantage de pétrole. Le maximum de la production sera atteint. D’où une hausse de prix qui s’intensifiera de plus en plus à mesure que la production décroîtra. Les initiatives de transition ont en point de mire notre futur énergétique et sont mobilisées par les réponses à apporter aux différentes crises, dont celle qu’induira évidemment le pic pétrolier. Rob Hhopkins, le créateur du modèle de transition, définit ainsi l’aspect positif d’une «descente énergétique » : «La descente énergétique se réfère au scénario d’un futur dans lequel l’humanité s’adapte avec succès au déclin des énergies fossiles disponibles et devient plus locale et autosuffisante». L’objectif d’un groupe de transition est notamment de mettre en oeuvre un plan d’action énergétique, où la dépendance au pétrole est minimale et ce, en se projetant sur 20 ans.
La résilience en ville…
Les groupes de transition diffèrent des autres groupes écologiques dans leur façon de concevoir la mise en oeuvre de leurs actions. Il s’agit avant tout d’une façon de penser la chose. Ainsi, le groupe doit d’abord visualiser l’objectif à atteindre dans 20 ans. C’est à partir du moment où cette visualisation est effectuée qu’il y a des chances d’atteindre cet objectif. Par ailleurs, le concept de résilience est prioritaire, alors qu’habituellement c’est la notion de durabilité qui est mis en avant. La différence est simple à comprendre. Avec la durabilité, on trie les déchets et on les expédie au centre de tri, tandis qu’avec la résilience, on les recycle sur place en les transformant, par exemple, en matériaux d’isolation.
Des groupes organisés
Les initiatives de transition sont effectuées par les communautés dans leur ensemble. Ttous les acteurs de la vie sociale devraient être impliqués dans l’idéal : le groupe à l’origine de l’initiative, mais aussi les associations, les administrations, tous les secteurs professionnels, les actifs, les retraités, les enfants… Il est donc essentiel d’arriver à former des groupes solides. Des étapes ont été définies afin d’y arriver. Citons : la formation d’un groupe de pilotage temporaire qui maîtrise parfaitement les notions de pic pétrolier et de dérèglement climatique et d’initiative de transition. Ce petit groupe va se charger des étapes à suivre jusqu’à la création de grands groupes de travail qui se focaliseront sur divers aspects de la vie quotidienne de la communauté : alimentation, déchets, éducation, jeunesse, transports, etc... Ces grands groupes de travail ont leur propre façon de fonctionner. Sera ensuite rédigé un plan d’action énergétique basé sur les travaux des différents groupes pour parvenir à des objectifs à moyen et long terme [15 à 20 ans et plus]. On le voit : il s’agit d’un véritable processus.

la création de monnaies locales
Que peuvent faire les groupes qui s’engagent dans ce processus ? Une multitude de choses, sachant cependant que l’implication du secteur économique est essentiel. Aussi les créations de monnaies locales se présentent-elles comme de véritables outils de résistance. Elles préservent la richesse locale, puisqu’elles sont à l’abri des turbulences boursières et autres crashs et cahots de la finance mondiale. Et elles encouragent bien évidemment l’échange entre les personnes, les commerçants, les entreprises qui les utilisent et qui sont situés dans un même territoire. Elles ne se substituent évidemment pas à la monnaie officielle, mais ont le soutien des autorités et des banques. Soixante- quatre monnaies locales existent en Allemagne, deux en Angleterre, trois en France. Plus d’un million de «Berkshares » circulent en Amérique, près de Boston. Ces monnaies sont une façon locale de répondre à l’incertitude économique mondiale actuelle.
Privilégier les «circuits courts»
Rappelons qu’il s’agit, dans les «Initiatives de transition», de valoriser tout ce qui est local. Qui dit ressources locales dit économie importante d’énergie. Oon peut donc privilégier, multiplier, amplifier ce qu’il est convenu d’appeler les «circuits courts», à savoir un circuit de vente qui fonctionne avec le moins d’intermédiaires possibles [tels que les paniers bio & AMAP], sur une base régionale ou locale. Ce type d’initiatives est hautement dynamique et réjouissant. Ceci dit, la ville n’est pas toujours synonyme de rencontre et de communion dans un même idéal. Loin s’en faut. C’est plutôt rare, à vrai dire. Rare et donc précieux.

Parfois, en ville, on peut juste reconnaître la présence de l’«autre». Seulement cela. Et c’est déjà beaucoup. Car reconnaître l’autre, le différent, celui que l’on ne rencontre que dans la ville multiple, celui qui mendie, celui qui crie dans le métro, celui qui est insoutenable, celui qui nous dérange dans nos méditations confortables, vraiment, ce n’est pas facile. Nous ne savons pas quoi faire. C’est aussi cela, la ville. Ce n’est pas lisse, ce n’est pas prévisible ; l’inattendu se trouve au coin de la rue. ça dérange. ça vous met toujours face à vous-même, comme un miroir...
Marie-Andrée Delhamende
A lire
- «Demeure terrestre. Enquête vagabonde pour l’habiter», Thierry Paquot, éd. L’imprimeur.
- «La ville en mouvement», Francis Godard, Editions découverte Gallimard.
- Revue : «Manière de voir, décembre 2010» : «L’urbanisation du monde».
- «Faire la ville autrement» et «Ville, démocratie et citoyenneté : l’expérience du pouvoir partagé»
de Patrick Norynberg aux Editions Yves Michel
- (re)localisation, (ré)appropriation, (ré)enchantement, de Stéphanie Hembise, édité par Les Amis de la Terre : voir rubrique «à lire...».
Paru dans l'Agenda Plus N° de

