Le sport, le complément non-alimentaire
Une activité physique et sportive ? C’est un choix. Une préparation. Un effort.
Aussi une façon de progresser intérieurement.
Et un grand plaisir...
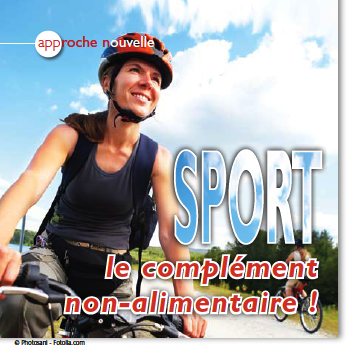
Téléchargez ici la version du dossier au format PDF
A l’époque médiévale et à la Renaissance, le mot «desport» apparaît. Il veut dire «s’amuser». Et c’est vrai que les nobles s’amusaient en joutant avec les joutes, le jeu de Paume, la crosse. Au 17ème et au 18ème siècles, on continue à se divertir avec des activités physiques toujours relativement aussi guerrières (réservées à la gent masculine) puisque c’est le temps où la chasse et l’escrime font fureur. L’équitation apparaît également. Mais c’est dans la deuxième moitié du 19ème siècle que les premières associations sportives voient le jour. La toute première association, c’est un club d’alpinisme créé en 1857. Puis viennent le football quelques années plus tard, l’athlétisme, la natation, etc. Les activités physiques deviennent peu à peu des « sports » en se dotant d’une organisation entre membres et d’une codification.
Enviable…
Les jeux olympiques renaissent en 1896 à Athènes sous l’égide de Pierre de Coubertin, dont on connaît la formule qui, bien que fameuse, n’en reste pas moins belle : «L’essentiel, c’est de participer ». C’est vrai que le sport, s’il ne garde pas en point de mire les notions originelles de jeu et d’amusement, peut dégénérer en surcompétition. Car le sport moderne s’est développé avec la notion de compétition. Des grandes manifestations telles que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, puis le Tour de France y ont contribué. Avec la télévision, toute la planète halète aux mêmes matchs ! Le sport-spectacle fait désormais partie de nos vies, ceci dit sans que ce soit nécessairement péjoratif. Suivre les Jeux Olympiques peut se révéler divertissant et instructif, voire émerveillant. Regardant les athlètes, on admire combien un corps en mouvement est beau !
Beau et enviable…
Pour tout un chacun, la pratique d’un sport est effectivement hautement enviable. Mais de là à s’y mettre réellement, il y a plus d’un pas. Certaines personnes ont réellement du goût pour le sport et cela, depuis l’enfance. D’autres moins, voire pas du tout. Différentes motivations pour faire du sport, donc. Les uns en feront par goût, les autres par envie de rester en forme, les troisièmes parce qu’ils veulent récupérer la forme qu’ils ont peu à peu perdue. Lorsqu’on est plutôt rouillé, intellectuel ou casanier, on se surprend évidemment à envier les personnes qui font du sport parce qu’elles aiment ça ! Ceci dit, à chaque personne son sport. Il suffit de faire le bon choix : le choix qui fera que l’activité physique est associée au plaisir et, comme l’indique l’étymologie, devient alors un «amusement». Dès que l’on s’amuse, on pratique tout à fait régulièrement son sport favori…
La personnalité, le corps…
Le choix du sport qui nous convient dépend évidemment de plusieurs critères. D’abord, le goût. Nous avons une inclination pour le basket, par exemple. Soit, mais au vu de cette inclination, observons le corps qui est le nôtre. Observons-nous. Sommes-nous fort, grand, petit, musclé, malingre, râblé ou longiligne ? Sommes-nous taillés pour le basket, la course à pied, ou le pingpong ? Quel est notre caractère ? Allons dans le sens de notre personnalité. Sommes- nous plutôt compétitifs ? Avonsnous beaucoup d’énergie à dépenser ? Alors, faisons de la lutte ou de l’escrime. Sommes-nous plutôt réfléchis ? Privilégions le golf et le tir à l’arc.
…et l’âge
L’âge est un second critère de choix. Dans l’enfance, les muscles et les articulations ont toute leur souplesse. On court, on saute, on grimpe, bref on joue en bougeant ; jouer fait partie intégrante de l’activité spécifiquement enfantine. Mais jusqu’à présent, il n’a pas été démontré que la pratique d’un sport avait un effet bénéfique sur la croissance d’un enfant. L’enfance, c’est le temps de la maturation osseuse et de diverses évolutions musculaires, respiratoires, organiques. Dès lors, il importe de ne pas faire de sport en dehors de sa catégorie d’âge. Par ailleurs, la diversification des sports est un autre critère important, vu qu’il n’existe pas de sport complet…

Des bénéfices
A l’autre bout, entre 40 ans et 55 ans, beaucoup de personnes ont envie de reprendre une activité physique après des années d’interruption. A 40 ans, le vieillissement physiologique est lent, mais présent. L’heure est aux sports d’endurance : la marche, l’aviron, le cyclisme, le jogging. On doit à la médecine sportive de ne pas seulement parler de «sport», mais d’«activité physique et sportive». Cette dernière ne nécessite pas nécessairement de devenir un athlète et d’être compétitif. C’est elle que doit viser les plus de 40 ans. Pour le sédentaire, l’activité physique et sportive s’avère tout bénéfice. Il est vrai que dans notre société technologique, la passivité physique est favorisée. Les stations devant l’ordinateur, la télé, la vidéo se disputent au cocooning sous la couette… ! Or, qui dit sédentarité dit risque de maladies cardio-vasculaires. Le sport peut remplir un rôle tout à fait utile car préventif.
D’autres bénéfices, en vrac. La fonction respiratoire améliorée, la baisse du mauvais cholestérol au profit de la hausse du bon cholestérol, une meilleure gestion des sucres dans l’organisme [d’où bonne thérapeutique pour les diabétiques], une augmentation de la masse osseuse [d’où moins de risques d’ostéoporose], une conservation de la souplesse articulaire, la conservation d’une masse et d’une énergie musculaire [que l’on perd d’autant plus que l’âge avance…], un maintien des fonctions neurologiques tels que l’adresse, l’équilibre, la vigilance, et l’équilibre retrouvé [car puissant moyen antistress].
«Je fais du sport pour moi»
Il importe donc de trouver le sport qui nous convient. Dans ce cas, l’effort est consenti et l’entraînement devient un plaisir. Valérie, 37 ans, a pratiqué durant l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte le ping-pong, le tennis, le volley, le squash, le vélo cross, le skate-board, le roller, le football, tous sports de compétition ou collectif. De 30 à 36 ans, elle réalise de longs trekkings en montagnes. A 37 ans, elle opte, comme beaucoup de personnes, pour un jogging avant de se rendre à son travail. «Le sport est un plaisir, dit-elle. Je fais du sport pour moi. J’aime sentir mon corps qui vit, la transpiration, les muscles qui tirent. Lorsque j’ai commencé à courir, je savais que cela n’allait pas être facile, mais grâce à l’entrainement et la pratique, j’ai acquis et je continue à acquérir une maîtrise et cela me procure du plaisir. J’exerce ma volonté, je supporte la souffrance si j’aime le sport que je fais. Je ne fais pas du sport pour le paraître, ou pour que mon corps soit beau. Ainsi, je ne fais pas des abdos parce que je n’aime pas cela. Il faut que le sport me plaise. Le jogging, cela me plaît. C’est facile, il n’y a pas de contraintes d’horaires, de clubs, d’entraînement. Je cours le matin avant de me rendre à mon boulot. Et je respecte mes limites.»
Bien s’équiper et s’habiller
Outre une bonne connaissance de soimême qui permet de ne pas dépasser ses limites, pensons à bien nous préparer à l’effort. D’abord, en se dotant d’un habillement et d’un équipement adéquats. Une bonne raquette. De bons skis. De bons habits aussi. Pensonsécologique, si c’est possible. Pourquoi ne pas recourir, par exemple, aux excellents pantalons en chanvre-bio pour joggeurs ? Bien s’habiller, lorsque l’on fait du sport, c’est aussi tenir compte de la chaleur et du froid. Si on court, on fait un effort, et donc on transpire, même en plein hiver. Il existe des vêtements réalisés dans des matières qui isolent du froid tout en respectant la transpiration. Par ailleurs, tout ce qui est exposé à l’air doit être protégé. A nous les crèmes protectrices pour le visage et le nez, les bonnets pour la tête et les oreilles, les gants pour les mains. Une mention particulière pour les pieds, à garder toujours bien au sec. Prévoyez plutôt deux paires de socquettes plutôt qu’une. Quant au soleil et à la chaleur, la logique prévaut. Protection de la tête, des yeux, de la peau. Et inutile de se couvrir pour transpirer en croyant que l’on va perdre du poids... on n’aura perdu que de l’eau que le corps va très vite récupérer après l’effort.

L’effort pour le sprint
L’effort. Maître mot, à la fois honni et désiré. L’effort fait intégralement partie d’une activité physique et sportive. En gros, il existe deux grands types d’effort : l’un pour le sprint et l’autre pour la marche. Lorsqu’un sportif sprinte, ou soulève un haltère de 100 kg, ou sert la balle de tennis, il sollicite immédiatement toute sa réserve d’énergie. Il n’y a pas de «mise en route», mais un effort intense et explosif de courte durée. Le corps puise dans des réserves d’énergie -réserves minimes- constituées par des molécules de très haute énergie se trouvant dans les muscles, autrement nommées ATP [Adénosine Tri Phosphate]. Cette ATP permet la transformation de l’énergie chimique en énergie mécanique. L’action musculaire possible est très brève, d’une minute à deux minutes maximum. Puis la réserve est épuisée, et un nouvel effort intense est impossible à produire. Le corps doit «récupérer» sa capacité énergétique.(1)
L’effort de longue durée
L’autre type d’effort permet, au contraire, de pratiquer une activité physique dans la durée. Le sportif - lorsqu’il marche, fait du jogging, du vélo, de la natation, du ski de fond, etc... - produit un effort continu dont l’intensité est moyenne. L’énergie nécessaire ne doit donc pas être puisée dans la petite réserve dont le corps dispose pour produire un effort intense, comme le sprint. Le corps doit au contraire être amené, paliers par palier, à produire l’énergie nécessaire, d’où la nécessité de l’échauffement. L’échauffementconsiste à mettre en route les systèmes et les organes sollicités: le coeur, les poumons, les globules rouges et l’hémoglobine, le capillaire. Tous ces éléments interviennent dans le processus de transformation des sucres et des graisses en énergie. [Petit rappel : les sucres et les graisses sont stockés dans le foie, mais aussi dans les muscles…].
Step by step
Si le sportif ne procède pas à un échauffement, l’organisme est immédiatement sollicité «à plein régime». Il doit faire face immédiatement à une demande à laquelle il n’est pas habitué. Le coeur « pompe » tout de suite trop vite ! Alors que le rythme cardiaque doit, au contraire, être haussé progressivement. Idem pour les muscles et les tendons. Ils sont sursollicités tout à coup. Or, leurs capacités élastiques ne sont pas encore mises en oeuvre. Les fibres musculaires ont besoin d’être tout doucement étirées, puis contractées, puis étirées à nouveau, afin de s’habituer aux mouvements et aux efforts inhabituels qui vont leur être demandés. D’où la nécessité absolue d’un échauffement, autrement dit d’une activité modérée durant une durée minimum de 5 à 10 minutes : une marche active, un petit trot, des sautillements, et surtout des étirements…
Récupérer
S’il est bon de s’échauffer avant l’effort, il est tout aussi nécessaire de récupérer. En effet, en plein effort, les muscles en activité font remon-ter le sang vers le coeur. Si le sportif coupe brusquement son effort, il ya une chute de la fréquence cardiaque et donc de la pression artérielle. Ceci peut entraîner le malaise vagal et divers maux, dont des sueurs froides, des nausées, des vertiges, un flou visuel, voire un évanouissement. Après un effort, il est conseillé de ne pas s’asseoir, mais au contraire de continuer à s’activer modérément quelques temps. Par exemple, marcher sur une centaine de mètres. Vient ensuite une récupération plus passive où la sédentarité est au menu : l’organisme et les muscles sont mis au repos. Déconseillé : la douche chaude. En effet, l’eau chaude dilate les artères. Or, celles-ci sont déjà dilatées par l’effort. Mais aucune contre-indication, en revanche, pour les douches tièdes ou froides…

Juste des carottes râpées… ?
Avant, durant et après l’effort, il faut aussi boire et manger. Il est impératif, pour le métabolisme, de maintenir la quantité suffisante de sucres et de graisses, qui se transformeront en énergie. D’où la nécessité de s’alimenter correctement, ceci sans se fruster. Ce n’est pas parce que l’on reprend une activité physique et sportive qu’il faut se croire obligé de s’en tenir uniquement aux carottes râpées. Par ailleurs, il faut déboulonner l’illusion qui consiste à croire que l’on va automatiquement maigrir parce que l’on fait du sport. Il se peut même que l’on soit amené à avoir des besoins alimentaires accrus, vu que le sport fait brûler l’énergie.
Trop grosse, mais sportive quand même !
L’essentiel est de trouver son équilibre, et le poids où l’on se sent en forme. Autre idée fausse à éviter : ce n’est pas parce que l’on est en surpoids que l’on doit éviter de pratiquer une activité physique. Ecoutons Gaëlle, 38 ans, qui a pratiqué durant de nombreuses années du sport avec un surpoids. Pour 1,60m, elle pesait de 80 à 90 kg, ce qui n’est plus le cas actuellement, vu qu’elle est passé de 80 kg à 60 kg, ceci grâce à une meilleure connaissance d’elle-même et de ses besoins réels, à une alimentation plus équilibrée, et à la reprise d’une activité sportive délaissée durant 2 années. «Lorsque j’étais en surpoids, faire du sport n’a pas été un problème» témoignet- elle. «Mon corps était gros, mais très souple et résistant. Le tout, c’est de connaître ses limites. Il ne faut pas casser le corps».
Un mouvement physique et psychique
L’effort sportif, lorsqu’il est correctement géré, permet à la personne de se confronter à un dépassement. Ce n’est pas toujours facile de «s’y mettre». Il faut exercer sa volonté pour se rendre dans une salle en plein hiver, assister régulièrement aux entraînements, ou même se mettre à courir seule… ! «Lorsque j’ai le moral bas, je n’ai aucune envie de courir», dit Valérie, «mais une fois que j’ai fait l’effort de m’y mettre, je suis en mouvement. Courir suscite un mouvement non seulement physique, mais aussi psychique». En ce sens, grâce à cette «mise en mouvement», pratiquer une activité physique régulière est thérapeutique.

Débrancher la prise du mental
Thérapeutique car affronter l’effort incontournable que requiert une activité physique et sportive équivaut bien souvent à relever un défi. Il y a un challenge à arriver à courir au moins deux fois par semaine, alors qu’au départ, on n’a jamais pratiqué le jogging. Lorsqu’une personne arrive à vaincre son inertie et son manque de confiance en elle, et qu’au bout de quelques semaines, elle parvient à courir une dizaine de minutes sans s’interrompre, elle ressent une très grande satisfaction personnelle. Par ailleurs, la pratique régulière d’une activité physique et sportive devrait fait partie des prescriptions médicales, tant elle déstresse. Et ce n’est pas peu dire que notre société génère un stress important. Stress qui entraîne bien souvent des ruminations mentales, des soucis, des idées fixes, des maux de tête, des contractions, des tensions, des crispations. Nous sommes pour la plupart bien trop «remplis» de préoccupations diverses. «Lorsque je pratique un sport, je me dépense et donc je me vide mentalement », dit Valérie. «Dans les périodes de rumination, de soucis, ou dans les périodes d’examens, le sport parvient à me faire débrancher la prise du mental. Et ça, c’est précieux !»
Des multiples «voies»
Toute activité physique donne au pratiquant l’occasion d’expérimenter autrement son rapport au mental, et donc à l’harmonie entre le corps et l’esprit. Dans les arts martiaux, les activités physiques sont de véritables «voies» qu’emprunte le pratiquant pour aller vers une maturité intérieure. Ainsi, le taekwondo est traduit par «la voie du pied et du poing», le jiu-jitsu et le judo signifient la «voie de la souplesse», le kendo la «voie du sabre». On parle «d’arts» martiaux. Il est à noter que tous les arts du Japon, que ce soit l’art des bouquets, de la peinture, du chant, du thé - et audelà, tout acte quotidien, que ce soit marcher, s’asseoir ou se lever - représentent une «voie». Ce qui est visé est l’affranchissement du «moi» afin que tout acte «coule» naturellement, comme un fleuve coule dans le bon sens. Les disciplines que sont le judo, le kendo, etc..., sont avant tout des pratiques initiatiques. Il s’agit d’une initiation à l’affranchissement du «moi», à la stabilité et à l’harmonie, et ultimement à la liberté intérieure.
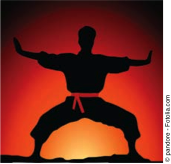
Golfeur dans l’esprit zen
Cette démarche ne fait évidemment pas l’économie de l’effort, de la discipline, de l’entraînement. Loin de là car, comme dans le sport, la maîtrise technique est nécessaire. Sans une grande persévérance et un entraînement sur le long terme, aucune maîtrise ne peut advenir. Si l’on répète sans cesse le même mouvement, on arrive à la maîtrise. Ainsi, un joueur de golf peut acquérir une grande maîtrise sur le court à force d’entraînement. Cependant, pour le Japonais, la maîtrise de la technique n’est que la première étape. En effet, reprenons l’exemple du joueur de golf. Si ce joueur, lorsqu’il lance la balle, est déconcentré par un chien qui aboie, il va manquer son objectif. Il peut être un grand technicien, mais sa technique ne lui aura servi à rien, car elle ne représente qu’un savoir-faire. Mais s’il reste bien ancré et concentré, non atteint par ce qui l’environne, il pourra exercer son art. C’est ainsi que ce joueur pourra être qualifié de «maître» au sens de «maîtrise » car il se maîtrise lui-même. L’action extérieure peut être parfaitement accomplie parce qu’il y a une maîtrise intérieure.
Une cible à 3 m pendant 3 ans…
Dans la vision japonaise, ce qui est paradoxal et fascinant, c’est que la pratique de quoi que ce soit représente la voie de la transformation intérieure. Le judoka, le tireur à l’arc, mais aussi - pourquoi pas ? - un joueur de golf ou un cycliste peut considérer que l’objectif d’atteindre une excellence dans sa pratique est un moyen pour se transformer. Ainsi la voie orientale peutelle devenir une façon de considérer les choses tout à fait «exportable». Karlfried Graf Dürckheim, qui a suivi de nombreuses années l’enseignement des maîtres japonais, raconte une histoire qui traduit combien le tir à l’arc fut pour lui une école de maturation intérieure. Le premier jour qu’il se rendit à son exercice de tir à l’arc, il fut très étonné. Dans un jardin se trouvait la cible. On ne pouvait la rater : c’était une botte de paille de 80 cm de diamètres qui se trouvait à la hauteur des yeux, fichée sur un support en bois. Tout élève devait s’exercer devant cette cible pendant 3 ans, à une distance de seulement 3 mètres ! On comprend immédiatement que le but recherché n’était pas uniquement d’atteindre la cible. De quoi s’agissait-il donc ?
Le résultat intérieur
Un jour, Dürckheim est particulièrement fier de montrer à son maître combien, après des semaines d’entraînement, il exécute avec excellence les mouvements pour bander l’arc. Le Maître le regarde faire. Puis au moment où Dürckheim va lâcher la flèche, le Maître lui prend l’arc des mains et retend la corde en lui disant de recommencer. Dürckheim recommence, mais la corde étant deux fois plus tendue, il n’y arrive pas. Il réessaye, recommence encore et encore. Mais non, c’est impossible. Il perd même l’équilibre à un certain moment. Le Maître, devant la mine dépitée de Dürckheim, rit, puis lui dit qu’il a immédiatement constaté, rien qu’à sa manière de saisir l’arc, que Dürckheim avait acquis une très bonne technique. «Mais, lui dit-il, ce n’est pas l’important. Au fond, il ne s’agit pas d’envoyer la flèche droit au but. L’objectif essentiel n’est pas le résultat extérieur, mais le résultat intérieur, autrement dit la transformation intérieure de l’homme.» Et de lui poser cette question : «Quel est le plus grand danger qui puisse menacer sa transformation, sinon de s’arrêter au résultat acquis ? L’homme doit progresser, progresser sans cesse»
Se transformer par le sport ?
Ce qui est mis en avant dans ses paroles, c’est l’incessant travail d’humilité, de transparence, d’effacement de soimême qui permet que l’homme soit uni avec son centre vital. Alors advient une action «juste» où les forces profondes dont il a besoin pour l’accomplir peuvent surgir. Dans cet esprit, tout sport, que ce soit le patin à roulettes, le twirling bâton des majorettes, la course landaise, la marche athlétique, la bicyclette, ou toute autre activité physique, s’accroît, pour celui qui y est sensible, d’une dimension essentielle et passionnante…
Marie-Andrée Delhamende
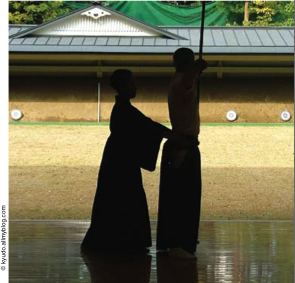
(1) Les infos sur la notion d’ «effort» sont développées dans «Guide sports santé», A Ducardonnet, G. Porte, P. boulanger, Edition 1, 1995 (en bibliothèque).
LIVRE - K. Graf Dürckheim, «Hara, centre vital de l’homme»,
Editions le Courrier du Livre
Paru dans l'Agenda Plus N° de

