Faire revivre les potagers
Le jardin potager.
Ou privé, ou collectif,
ou urbain, ou campagnard,
ou biodynamique,
ou biologique,
ce serait bien qu’il soit
jardin solidaire et
poétique. Qu’on soit
amis, en tout cas…
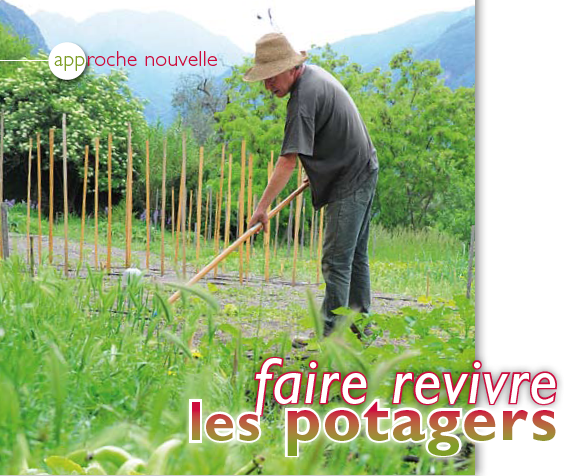
Un jour, on a envie de travailler la terre et de manger les légumes de son jardin. On se relie ainsi, sans toujours en avoir conscience, à ces millions d’hommes et de femmes qui font de même à travers le monde ou qui pendant des siècles, avant nous, ont fait de même dans nos pays. En effet, pendant très longtemps, en Europe, la principale source alimentaire du peuple était des repas de légumes du jardin.
«As-tu déjà mangé le légume ?»
Les paysans consommaient des légumes à tous les repas, comme le montre le parler populaire de Malmédy. Ainsi, le déjeuner était appelé «bouillie», le dîner «sop» [soupe] et le souper «môs» [légume].
Le soir, les paysans se saluaient en disant : «Hast-t Mâs alt gegessens ?», ce qui signifie «As-tu déjà mangé le légume ?» [voir livre de Ph. Delwiche en fin d’article].
Désirant travailler le jardin potager, nous aussi, mangerons «le légume» mais avec le privilège de pouvoir l’assaisonner ou l’accompagner d’un civet si nous sommes carnivores, ou d’une poêlée de dés de tofu en tant que végétariens, si c’est le cas. Nous voulons donc un beau jour avoir pignon sur jardin potager et consommer légumes savoureux et frais. L’envie nous titille. Cela peut être simple envie de mettre ses mains en terre. Et cela peut se coupler avec des raisons écologiques, politiques et autres convictions. Un combat quotidien auquel on croit. Et cela donne NON à la malbouffe, au fastfood, au prêt-à-chauffer, NON aux intérêts du commerce lobbyiste qui prennent le pas sur les intérêts de la santé publique. Et OUI aux légumes frais, riches en éléments nutritifs et savoureux. OUI au fait de savoir ce que l’on mange. OUI à une relative autonomie alimentaire peu coûteuse et non dépendante du marché. OUI à des légumes locaux sans emballage qui réduisent l’empreinte écologique. OUI à la culture des variétés en voie de disparition. OUI au respect de la terre, des animaux, des plantes. OUI au respect de la santé. OUI à la biodiversité. OUI à l’être humain en lien avec la nature. S’ajoutera peut-être, et on le souhaite, OUI à la culture bio...
Comme une personne…
Oui. Petit mot qui ouvre à l’acceptation. Dire OUI à son jardin potager. C’est comme dire «oui» à une personne. On peut, en effet, comparer chaque jardin potager à une personne avec laquelle on entre en relation profonde. De la qualité de cette relation dépendra notre bonheur commun. Il importe donc de connaître la personnalité de notre bout de terre. Car de même que tout organisme vivant, notre jardin a une personnalité à nulle autre pareille. Cela dépend de son passé [un jardin cultivé depuis cent vingt ans est différent d’un nouveau jardin], de son ensoleillement, des plantes déjà existantes, de la nature du sol, de l’eau disponible, des animaux qui le visitent. Comment est-il, mon jardin ? Quelle tête a-t-il ? Comment évolue-til, selon les saisons, Comment, en bref, vais-je le mieux le servir ? Comment vais-je le faire s’épanouir ? Comment vais-je respecter sa vie ?
Le bon amour…
Ce ne sont pas de vains mots de dire que le jardin est vivant et donne la vie Entre le sol, la flore et la faune, de multiples échanges ont lieu. Les animaux et les fleurs se nourrissent de ce que le sol produit. Nous pouvons donc favoriser la bonne santé de tout ce petit monde et respecter sa diversité.
Toute la relation au jardin peut être changée si on se met à lui vouloir du bien et à l’aimer. Mais oui, en fait, c’est une histoire d’amour. Une histoire de bon amour. Et comme toute histoire d’amour, elle demande choix, apprentissage, connaissance, discernement, soins constants, renouvellement perpétuel et fidélité.
D’abord, sachons que la terre sur laquelle nous allons cultiver notre jardin potager ne nous appartient pas réellement. Elle est confiée par la nature qui nous la prête à notre bonne garde. Nous allons en prendre soin. Les légumes ont, en effet, besoin d’une terre riche où pousser. Lorsque nous invitons un ami à notre table, nous lui donnons une bonne nourriture, preuve que nous l’aimons bien et que nous le respectons. Il en est de même de notre terre et de nos légumes. On ne va pas arroser les légumes de quantité de produits chimiques. Mais on va nourrir le sol. Car c’est ainsi qu’est respectée la nature dont notre jardin potager n’est qu’une parcelle que nous avons, rappelons-le, délimitée artificiellement. Car fondamentalement la vie de notre potager fait partie de la vie sauvage, comme l’explique si bien l’association Nature et Progrès : «Si nous arrivons à comprendre les principes essentiels de la vie sauvage, nous comprendrons aussi la vie de notre jardin».
Prendre soin de…
Que nous soyons hommes ou femmes, nous apprenons à développer notre côté parental, en prenant soin d’un jardin potager. Ce sont des soins maternels et de bon père que nous donnons à notre Terremère dès que nous jardinons. Nous lui rendons la pareille, après tout. Puisque c’est elle qui nous donne nourriture et subsistance de la naissance à la mort.
Les soins à apporter visent à faire croître, protéger et nourrir. Ainsi, le sol souffre s’il est nu en hiver. Il faut l’aider à ne pas souffrir du froid, de la pluie, de la neige. Les plantes doivent également être nourries, fumées, protégées contre les maladies et les parasites. Des beaux légumes peuvent sortir de là. Ce ne sont pas n’importe quels légumes. Ce sont les nôtres. Comme l’explique Françoise : «Lorsque j’apporte mes poireaux à table, j’ai l’impression que j’apporte une petite partie de moi-même. Il y a un plaisir créateur à faire pousser des légumes».

Un travail personnel
Les légumes sont issus d’un travail personnel. Il y a une relation, ce qu’exprime parfaitement Fanchon, 56 ans, professeur de chant, femme dynamique : «Me mettre personnellement à la tâche pour cultiver mon petit bout de terre en la soignant bien et en profitant de ce qu’elle m’offre à manger, équivaut à entretenir et transmettre la vie, et c’est assumer mon rôle de parent-propriétaire».
Toujours là, extraordinairement vivant
Dès que l’on s’investit dans le jardin, on revoit bon nombre de ses valeurs à la mesure de la pratique du jardinage qui se déroule tout au long de l’année. Car le jardin ne quitte pas la pensée du jardinier. Le jardin est là, extraordinairement vivant. Extraordinairement varié. Tout participe du jardin.
La mort et la vie. Les roses. Les rats. La prolifération des mousses. La floraison inouïe de l’arbre qui va mourir. Les perce-neige. Les racines du liseron. Le rosier grimpant. Les légumes. Ceux qui sont mangés par les vers, ou par les limaces. Ou les cueillis, ceux que nous mangerons…
Et on contemple quotidiennement le mystère des forces de la nature. Elles nous dépassent. Tant dans l’infiniment petit d’une goutte de rosée qui roule sur une feuille de chou que dans la grandeur de l’orage.
On regarde son jardin, on l’observe, on essaie de le connaître et de le comprendre. Le jardinier accompagne son jardin, tout au long des saisons. Bref, le lien tissé entre le jardinier et le jardin est constant. Aussi, le rapport au temps devient-il différent dès que l’on entre en jardinage…

Potagers collectifs : «Le début des haricots»
Par ailleurs, le jardin nous offre un très beau cadeau : il nous permet d’entrer en relation avec les autres jardiniers. Les potagers collectifs se développent d’ailleurs de plus en plus, comme en témoigne l’asbl «Le début des haricots» qui recense les potagers collectifs et qui, pour 2012, en accompagne le lancement pour une durée de 9 mois dans la région de Bruxelles.
En ville, il suffit qu’une convention de mise à disposition du terrain soit signée entre le propriétaire du terrain et les habitants. Et puis, l’aventure commence… et c’est une aventure qui s’appuie sur «une volonté d’implication forte des habitants» où se trouvent réunis à la fois le fait de tisser des liens sociaux et de camaraderie entre les habitants et de répondre à leurs besoins de proximité avec la nature.
Bruno et ses amis
Ceci dit, chaque personne, si son terrain est suffisant, peut le donner à cultiver, en parcelles ou collectivement, à d’autres. Ainsi, à Couthuin, Bruno, en chaise roulante, a choisi de voir le côté positif de sa situation : «Je suis plus disponible qu’auparavant aux autres, et à tout ce qui se fait ailleurs, depuis mon arrêt de travail», dit-il. Bruno a donc donné à partager un grand jardin de plus d’1 hectare à des amis et des connaissances.
Le potager est entièrement collectif, non délimité par des parcelles, et les légumes sont partagés en fonction des besoins de chacun, la visée n’étant pas le profit personnel.
Un chemin…
Pour Bruno, l’aventure est d’abord humaine. «On a parfois des avis différents sur le potager, on apprend à accepter l’autre. On doit immanquablement s’ouvrir à l’autre, être à son écoute, et bouger».
Des expériences sont réalisées. Le groupe est souple, aucun fanatisme, chacun fait ses essais. On plante des fleurs et des simples, de l’absinthe qui attire les pucerons. On essaie d’arroser le moins possible, comme dans la nature. Et des légumes anciens sont restaurés, comme la tétragone et le topinambour.
«La nature nous montre le chemin», conclut Bruno, et de dire aussi que pour chaque personne du groupe, ce qui est important, c’est «comment, dans le potager, chacun se retrouve là où il est». Cela aussi, c’est un chemin…
Au jardin de l’Abbaye, mille rencontres légères…
Autre type de potager collectif avec Madame L. La famille de cette dame est, depuis plusieurs générations, propriétaire d’une abbaye ceinte de terres et agrémentée d’un bel étang. Dans les années ‘85, des petits potagers individuels ont été loués à des voisins, à un prix dérisoire, 3 à 5 euros l’année.
«Cela permet mille rencontres légères», explique Françoise, et d’ajouter aussi que jardiner, c’est «un travail qui délivre de toutes préoccupations et soucis. On est pris tout entier. Absorbé tout entier dans ce que l’on fait». N’est-ce pas, après tout, une forme de yoga, que d’être uni à ce que l’on fait ? Fanchon, quant à elle, confirme : «C’est une triple séance de gymnastique - relaxation - méditation ».

Interactions…
Le jardin est la résultante d’un nombre infini d’interactions entre des éléments de tout ordre. Ainsi, dans l’agriculture biodynamique, le climat, la nature du terrain mais aussi la Lune, le Soleil, les étoiles, les douze constellations du zodiaque, les animaux et la végétation évoluent en interdépendance. Et il est vrai que de multiples interactions jouent un rôle dans les processus de vie, de germination, de croissance, de floraison, de fructification, de maturation, de santé, de morbidité et de conservation d’un jardin. Ces interactions étaient connues des méthodes traditionnelles de jardinage et se perdent actuellement. Dommage.
…et héritages
Le jardin a traversé les siècles, s’enrichissant lentement de diverses variétés de légumes venant de tous les pays. Nous héritons actuellement des savoirs jardiniers, agricoles, paysans, horticoles - comme les savoirs des horticoles arabes qui sont tout bonnement prodigieux - des siècles passés. Créer un jardin potager, c’est honorer ces milliers d’hommes et de femmes qui, avant nous, ont pensé, expérimenté, cherché, pris soin de la terre. Se relier à la terre dont nous sommes redevables et dont nous faisons partie, c’est se relier, in fine, à l’humanité dans son ensemble…
Marie-Andrée Delhamende
Livre : «Du potager de survie au jardin solidaire » de Philippe Delwiche aux Editions Nature et Progrès Belgique.
Paru dans l'Agenda Plus N° de

